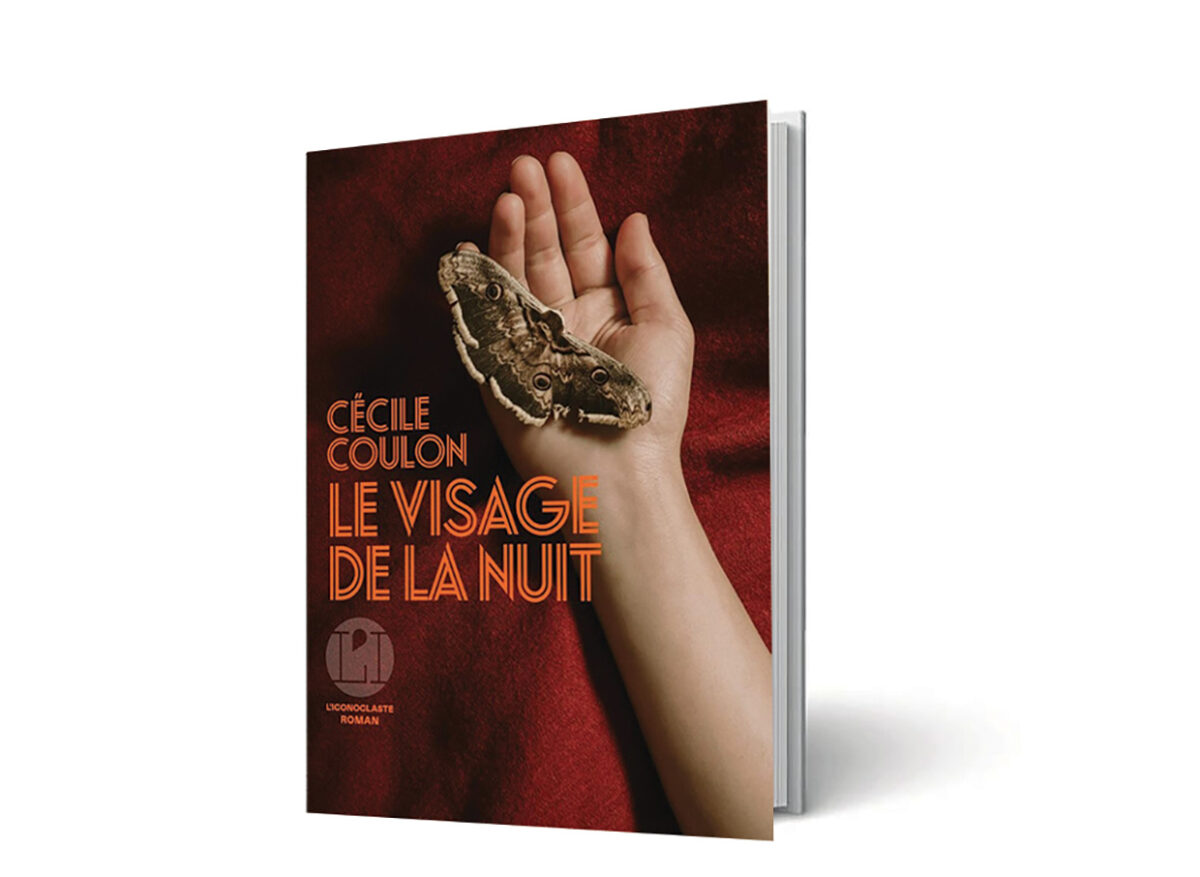Entretien. Cédric Andrieux évoque sa passion pour le Ballet de l’Opéra de Lyon qu’il dirige depuis 2023. Le regard est vibrant, le corps enthousiaste et la tête bien claire. À l’évidence, l’homme est à sa place !
Danseur au sein de prestigieuses compagnies, avec un grand écart qui l’a mené de Merce Cunningham à Jérôme Bel, puis directeur des études chorégraphiques au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, Cédric Andrieux a été nommé en 2023 à la direction du Ballet de l’Opéra de Lyon où il fut également danseur. Fin connaisseur de l’histoire de la danse, formé au management de compagnies et d’équipes artistiques, il entame la deuxième saison d’un projet artistique ambitieux, nourri de valeurs humaines bienfaitrices.
Lyon Capitale : Entre 2019 et 2023, le Ballet a connu deux crises avec les départs de Yorgos Loukos et Julie Guibert. À votre arrivée, dans quel état était le Ballet et de quoi avaient envie les danseurs et danseuses ?
Cédric Andrieux : Le Ballet était effectivement dans une phase de perturbations et Richard Brunel, le directeur de l’Opéra, avait dans le recrutement un souci d’apaisement, souhaitant lui trouver une forme de stabilité. Je pense qu’il y avait un fort attachement à l’ADN d’une compagnie de répertoire, qu’il était important de faire des créations mais également d’honorer de grandes pièces, aussi parce que c’est leur construction. Beaucoup ont un parcours académique classique d’excellence et ils sont fiers de ça. Peut-être les trois années de Julie Guibert étaient-elles plus portées vers la création avec aussi un projet assez radical qui les a un peu chamboulés. Ça a été une période de remise en question et d’ailleurs certains en sont très reconnaissants, cela leur a permis de se questionner sur ce qu’ils avaient réellement envie de faire mais il y avait effectivement cette idée de se retrouver dans le Ballet de Lyon, une des compagnies les plus importantes au monde, très présente en tournée, avec les artistes les plus doués de leur génération. Après, c’est intéressant car Julie a fait des recrutements audacieux avec des personnes géniales qui ont une autre vision de la danse, pour lesquelles la différence entre contemporain et classique est moins importante que pour nous en Europe où l’on est formé dans des écoles classiques.
Vous avez donc pris la direction du Ballet avec le désir très fort de faire dialoguer chefs-d’œuvre du répertoire et créations ?
Oui, car ce qui fait la force de cette compagnie, c’est sa faculté à articuler créations avec des artistes que je choisis parmi les plus avant-gardistes aujourd’hui en Europe comme dernièrement Marlene Monteiro Freitas et Nacera Belaza et en même temps à faire dialoguer ces créations-là avec des enjeux de répertoire. Il était déjà phénoménal avec plus de cent pièces, les grands maîtres de la danse de la deuxième partie du XXe siècle sont extrêmement présents – Anne Teresa De Keersmaeker, Mats Ek, Merce Cunningham, Jiří Kylián, William Forsythe, Trisha Brown… Il est important de continuer à montrer ces pièces sinon elles meurent et en plus il y a toute une génération de jeunes spectateurs qui ne les a pas vues.
Vous développez des actions de médiation et d’inclusion.
À mon arrivée, on a fait un séminaire pour se présenter, s’accorder sur des valeurs, des enjeux. Les danseurs ont exprimé le désir qu’il y ait une porosité entre le Ballet et les Lyonnais, avec aussi ceux qui ne viennent pas forcément les voir. Là, je me suis dit : “Bingo !” Et c’est comme ça qu’on a mis en place cette première année avec les HCL, auprès d’enfants malades avec des ateliers d’éveil et avec le collège La Tourette, autour de la découverte du répertoire. Avec les tournées, le planning du Ballet est compliqué à gérer, j’ai sanctuarisé des périodes pour libérer les danseurs, organisé une formation à la médiation pour les outiller, l’engouement s’est vite fait sentir puisqu’on renouvelle ces actions qui, par ailleurs, correspondent à toute la politique de l’Opéra.
Vous tenez aussi à la diversité des interprètes et des langages proposés sur scène ?
Le Ballet a toujours été une compagnie internationale mais qu’il puisse y avoir des interprètes racisés, représentant différentes cultures, n’a pas toujours existé, c’est une attention qui est plus contemporaine aujourd’hui. Je suis également vigilant à la pluralité des discours que l’on propose sur scène, au fait qu’il y ait autant d’hommes que de femmes, à accueillir et faire dialoguer des chorégraphes qui ont des origines différentes.
La porte de votre bureau, dites-vous, est toujours ouverte. Vous avez opté pour un management moins hiérarchisé et plus transparent.
Le bien-être des danseurs est important et je considère que ce sont des personnes responsables, je les écoute. Moi aussi je peux faire des erreurs et ils peuvent me le dire. Ils savent par exemple rapidement ce qu’ils vont danser la saison prochaine, voire celle d’après. Une communication simple en fait qui n’existait pas avant, mais c’est normal et pas uniquement lié à Lyon. Il y a eu une espèce de figure historique du directeur du ballet tout-puissant qui peut changer de distribution du jour au lendemain, virer une personne ou en encenser une autre. Ce ne sont plus des modes de management qui fonctionnent aujourd’hui car l’idée est de créer une adhésion à un projet, avec l’envie de faire des choses ensemble et je pense que toutes nos équipes sont embarquées dans ce même désir.
Vous avez créé un pôle santé au sein de l’opéra.
Oui, on a bénéficié d’une aide exceptionnelle de l’État et on a ouvert le pôle la saison dernière sur 70 m2 aménagés, j’ai également consolidé un partenariat avec la clinique Santy avec un médecin du sport. Ici, on a un staff santé de dingue, les danseurs viennent quand ils veulent, il y a des machines pour travailler la force, un bain à froid pour la récupération, des kinés… J’ai également rendu la classe du matin à nouveau obligatoire car elle était devenue optionnelle, or pour moi c’est un moment fondamental pour les danseurs et les danseuses et la cohésion de notre projet.
Quels sont vos critères en matière d’écriture de la danse pour la conception d’une saison ?
Je m’aperçois que je vais vers des créateurs qui ont un langage chorégraphique singulier. Il y a beaucoup de chorégraphes que j’admire dont la particularité n’est pas d’écrire de la danse, alors qu’ici on a des artisans de la danse, qui savent extrêmement bien danser et tout danser. Par exemple, Florentina Holzinger, au-delà du fait qu’elle est très provocante, fait de grands spectacles où il y a des corps en mouvement mais il n’y a pas un style chorégraphique. Or quand on voit une pièce de Childs ou Forsythe, on sait que c’est du Childs ou du Forsythe, ce n’est pas subjectif, c’est qu’il y a une réelle écriture d’un mouvement. Et là, on pense ce qu’on veut mais cette deuxième partie de Untitled 1, la création de Belaza pour le Ballet où ils sont dans des tourbillons, n’est pas accessible à tous les danseurs. Il faut une grande maîtrise de son centre, de la giration, une force créatrice très forte et je souhaite des créateurs qui soient en capacité de s’emparer de ça, qui sont intéressés par une virtuosité des corps et des pratiques, j’ai besoin que la virtuosité des danseurs soit questionnée à un endroit.
Comment avez-vous conçu la saison 2025-2026 ?
Pour moi, il y a une forme de grand engagement dans cette saison de la part des interprètes, une forme de combativité. On est un peu désarmé par rapport au monde qu’on est en train de vivre, on ne sait pas quoi faire, on a envie d’intervenir, d’agir, d’avoir un impact. Les œuvres présentées donnent du punch, ce sont des formes de coups de poing donnés par le corps. Évidemment ça ne va pas résoudre les conflits mais avant tout traduire comment on continue de s’engager, de respirer, de se battre. On le voit avec Nuits transfigurées où il est question de passion et d’intranquillité, avec Canine jaunâtre 3 qui nous fait rentrer dans une arène où se joue un dialogue entre quelque chose d’humain et le corps machine. En avril, un nouveau triptyque réunit trois chorégraphes emblématiques dans un programme sur une ligne de crête, tel le calme Avant la tempête : Lucinda Childs, William Forsythe et David Dawson. Celui-ci vient notamment avec une pièce sur pointes et cela faisait un moment que la compagnie n’avait pas été sur pointes, c’est important pour moi car cela symbolise une forme de virtuosité en danse classique. En fin de saison, Sharon Eyal fera son entrée au répertoire provoquant une rencontre entre le Ballet, la culture du clubbing et la musique techno. Et tout au long de l’année, on partira en tournées qui sont de plus en plus importantes, en région, en France et à l’international.
Ballet de l’Opéra de Lyon – Programme complet : www.opera-lyon.com