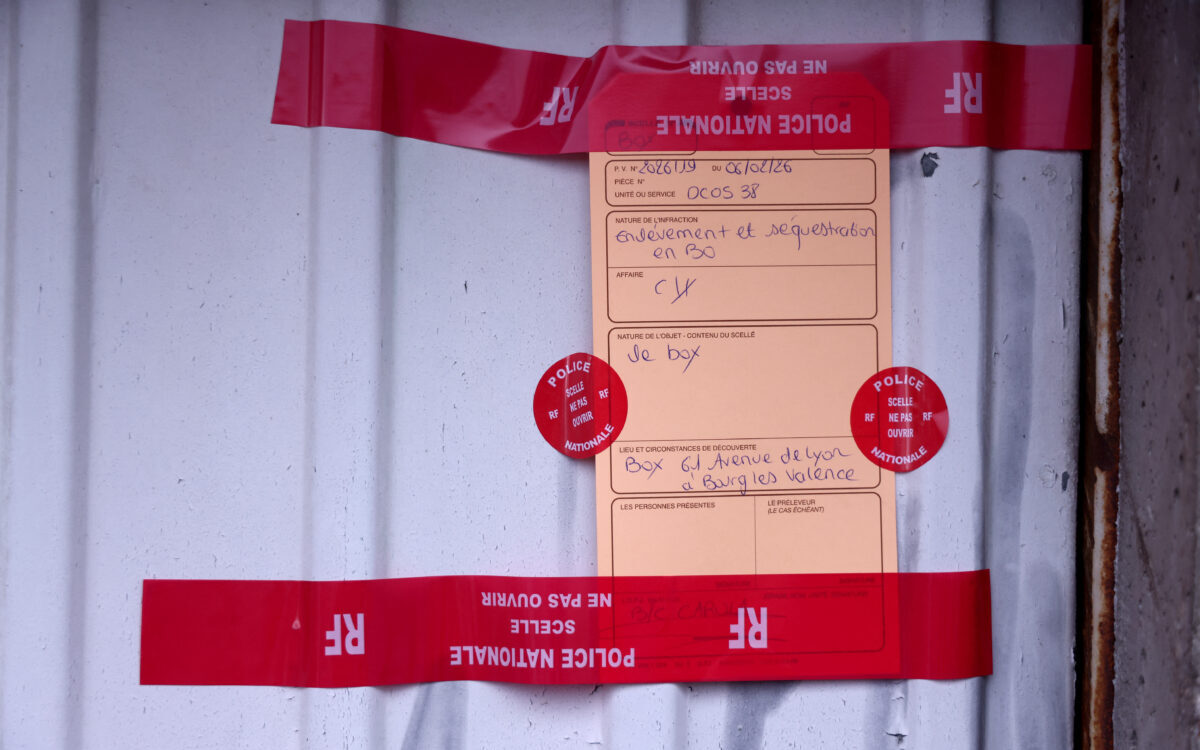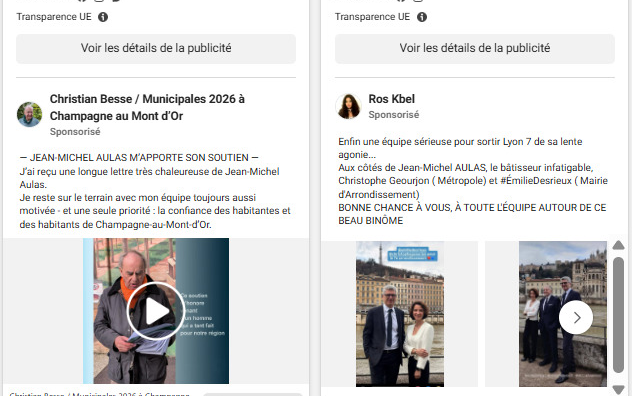Entretien avec l’avocat lyonnais André Soulier, qui a défendu avec succès un homme accusé du meurtre d’un enfant à Bron en 1963.
En 1963, alors tout jeune avocat âgé de 29 ans, André Soulier prend la défense de Jean-Marie Deveaux, accusé d’avoir tué la fillette de son patron à Bron. L’homme est condamné par la cour d’assises du Rhône à 20 ans de réclusion criminelle. André Soulier obtient la révision de son procès par une voie procédurale très peu utilisée par les avocats : le pourvoi dans l’intérêt de la loi. Ce pourvoi n’est ouvert qu’au garde des Sceaux. En 1968, c’était René Capitant et il accepta de l’introduire près la Cour de cassation. Jean-Marie Deveaux fut acquitté en 1969, au terme d’un second procès, par la cour d’assises de la Côte-d’Or. L’auteur du crime ne sera jamais retrouvé. André Soulier révèle pour la première fois à Lyon Capitale les dessous de cette procédure.
Lyon Capitale : Nous sommes en 1963, le verdict vient de tomber : Jean-Marie Deveaux est condamné à vingt ans de réclusion criminelle. Quelle est l’ambiance à l’époque ?
André Soulier : Un crime est commis, à Bron, un garçon avoue et se rétracte tout de suite. Même le juge d’instruction voit que quelque chose ne colle pas. On ne peut égorger et éventrer quelqu’un avec un tablier de boucher sans avoir une goutte de sang sur les vêtements. Lorsque je suis arrivé au poste de police du palais de justice pour le défendre, je vois un jeune homme en pleurs qui n’arrête pas de dire “Je n’ai pas tué Dominique”. Des procès-verbaux ont été dissimulés par des policiers. C’était un Alfred Dreyfus des banlieues. Je ne voulais pas en rester là, je me suis battu.
Quels moyens aviez-vous pour faire rejuger Jean-Marie Deveaux ?
Il n’y avait pas de possibilité d’aller devant la commission de révision, dans la mesure où le fait nouveau n’est pas apparu. J’emprunte une voie que personne n’avait utilisée depuis Napoléon Ier. Déjà, en 1963, Jean-Marie Deveaux s’est lui-même pourvu devant la Cour de cassation, en soutenant notamment qu’il n’avait pas comparu devant la chambre d’accusation. Il avait en effet comparu directement, en vertu d’un texte en relation avec des événements d’Algérie ! Pourvoi rejeté. En 1967, le nouveau député du Rhône Louis Joxe introduit un autre pourvoi, en arguant la violation des droits du condamné. La chambre criminelle de la Cour de cassation rejette ce second pourvoi. Mais je ne lâche rien, et là je trouve l’élément imparable.
Quel est cet événement, qui démontre que les droits de Deveaux ont été bafoués ?
Dix jours avant l’audience de 1963, le président de la cour d’assises Roger Combaz, l’avocat général Constant Quatre et le commissaire Durin vont ensemble sur les lieux du crime, à Bron, dans la cave. Le procès commence, et quand Durin vient à la barre il explique comment Deveaux a tué, comment le meurtrier s’est comporté. Lors du deuxième pourvoi, en 1967, un policier me dit qu’ils sont allés sur les lieux ; mais ceci n’était pas indiqué dans la synthèse. Comment le prouver cinq ans après ? Je trouve la preuve auprès de l’Administration : la sortie des trois hommes en voiture officielle a été clairement notifiée dans un document. Or, cette sortie devait se faire avec l’ensemble de la cour d’assises et non avec le seul président. À l’insu de la défense, le commissaire Durin, principal témoin de l’accusation, a sa citation de la cour d’assises déjà en poche. Il ne pouvait pas faire bande à part avec le président et l’accusateur public. Les droits de l’accusé ont été bafoués.
À ce stade, il faut convaincre, de nouveau, le garde des Sceaux de l’époque, René Capitant...
Je suis allé plusieurs fois à la chancellerie. J’ai 35 ans, et je suis face à René Capitant, dans son bureau. Il me dit : “On y va !” René Capitant m’avait affirmé que, si la chambre ne cassait pas, “nous ferions un scandale”. Ce qui ravissait mon cœur de jeune avocat, bien que j’eusse préféré une cassation. Le 26 mai 1969, de Gaulle est désavoué lors du référendum et quitte définitivement le pouvoir. Trois jours après, le 30 mai, la chambre criminelle casse le jugement en considérant que les droits de l’accusé ont été dévastés. À Dijon, j’étais blindé. Après quatre jours de débats et une déposition mémorable du juge d’instruction Roger Robin, j’ai obtenu l’acquittement.
Par la suite, j’ai préparé avec un autre garde des Sceaux, René Pleven, l’amendement qui allait permettre de rendre justice à des gens victimes d’erreurs judiciaires. La loi de l’indemnisation des gens ayant subi une détention et ayant obtenu un non-lieu, une relaxe ou un acquittement.
Que faudrait-il améliorer selon vous dans la loi ?
Tout tourne autour de la définition du doute. Si l’on retient la définition anglo-saxonne d’un doute envahissant, bien des procédures seraient mises à mal. Mais les choses ne sont jamais aussi simples qu’il n’y paraît. Par exemple, en matière génétique, il n’y a pas de reconnaissance formelle à cent pour cent : il peut exister deux personnes dont les caractères génétiques sont semblables. Si l’une est proche du crime en France et que l’autre réside en Papouasie, le doute scientifique n’est pas le même que le doute criminel !
L’affaire est d’une grande complexité, mais, si l’on considère les deux derniers siècles, les grandes énigmes ne sont pas si nombreuses. L’affaire du “courrier de Lyon”, jamais révisée avec cinq exécutants et six guillotinés. Ou l’affaire Seznec et l’absence de cadavre, car une personne disparue est-elle un cadavre ? Les erreurs judiciaires naissent du caractère maléfique de certains participants à l’affaire tout au long de la procédure : un policier, un magistrat, un expert et même un avocat.
-----
Cet article est extrait d’un dossier paru dans Lyon Capitale n°727 (novembre 2013).
-----
Tout notre dossier sur les erreurs judiciaires et la révision de procès au pénal est en ligne ici.