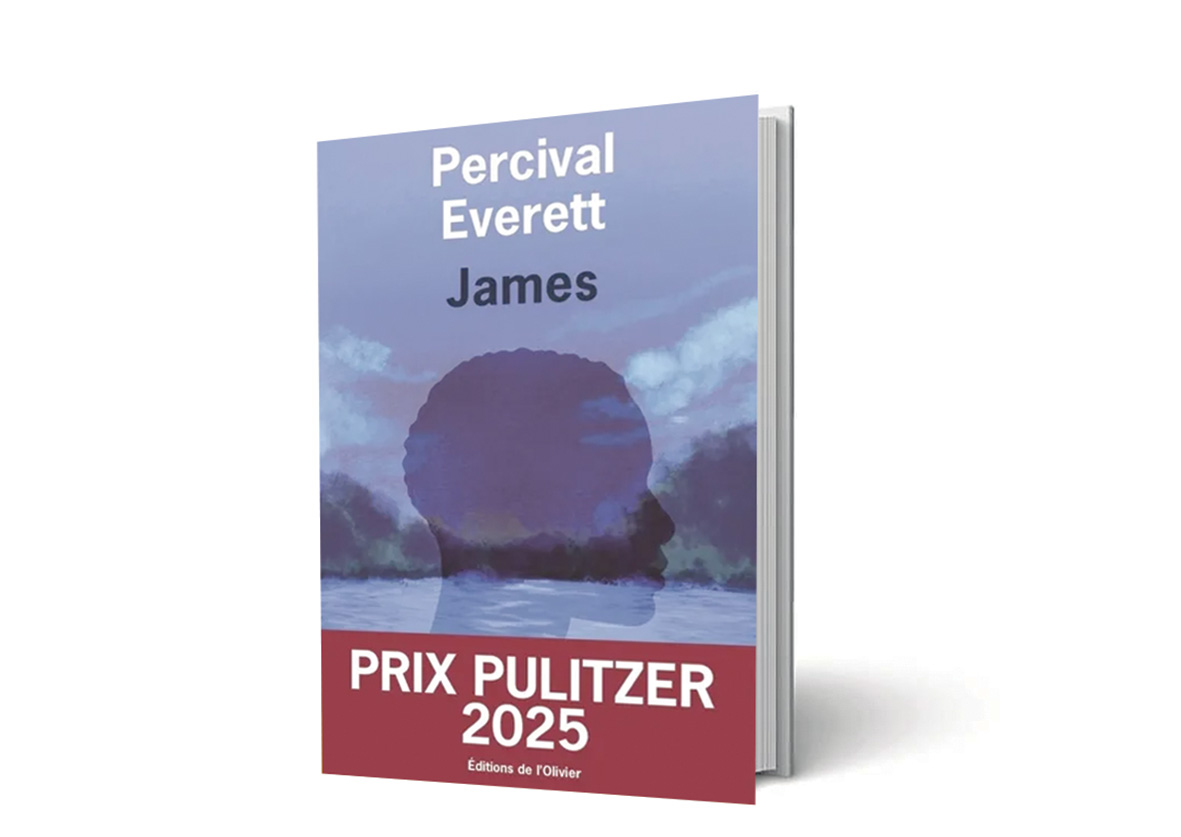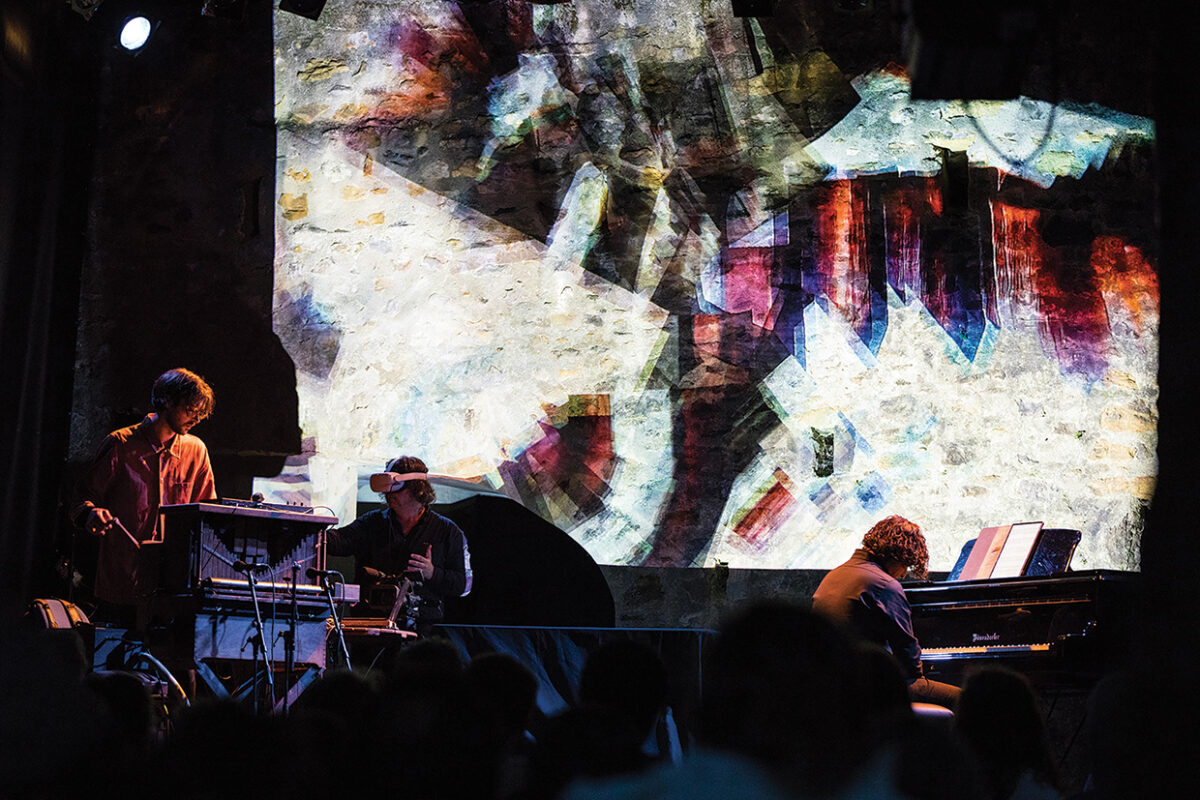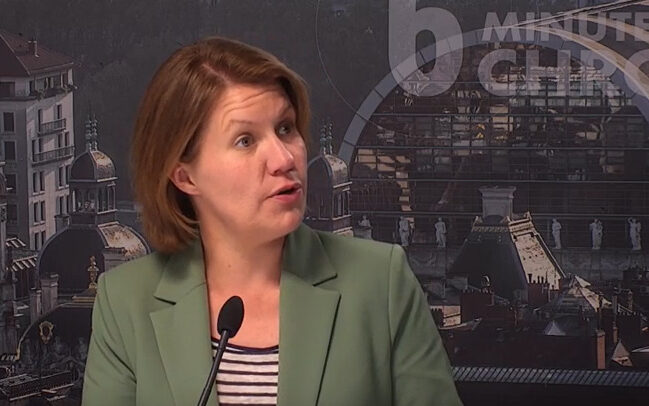Percival Everett, auteur de Glyphe et Effacement s’attaque à un monument de la littérature américaine, Les Aventures de Huckleberry Finn, qu’il raconte du point de vue de Jim, un esclave noir.
En 2014, Kamel Daoud avait publié Meursault, contre-enquête, une relecture de L’Étranger de Camus mais racontée du point de vue du frère de “l’Arabe” tué par l’anti-héros du roman. Aux États-Unis, un certain nombre de classiques sont également réécrits pour être nettoyés de tout contenu raciste, antisémite, homophobe, bref problématiques, en abolissant le plus souvent une réalité : celle de leur époque.
Percival Everett ne s’inscrit ni dans la veine du premier ni dans la tendance précitée qui donne aux éditeurs soit des sueurs froides, soit des rêves humides de tiroir-caisse. Pourtant, l’auteur de Glyphe et Effacement s’attaque à un monument de la littérature américaine, souvent cité comme le premier grand roman véritablement américain – c’est-à-dire affranchi de l’influence et de la langue de la littérature anglaise : Les Aventures de Huckleberry Finn. Qu’il raconte du point de vue de Jim, l’esclave noir qui partage le radeau de Huck à la descente du Mississippi, au prix de mille aventures picaresques et d’un voyage au cœur des ténèbres racistes.
Projet quasi-borgésien et bienvenu dans l’Amérique rétrograde de Trump. Car si Everett illumine différemment la question raciste en donnant la parole à Jim, son coup de maître c’est surtout de poursuivre le travail opéré par Mark Twain dans Huckleberry Finn, celui sur le langage vernaculaire, le phrasé oral et les sociolectes (un aspect du roman sur lequel l’écrivain David Carkeet avait effectué en son temps un travail d’analyse remarquable et qui donna bien des soucis à nombre de traducteurs).
Everett en fait même une mise en abyme doublée d’une forme de pastiche : Jim est un esclave lettré, admirateur de Voltaire (avec lequel il dialogue même en rêve) mais en présence d’un Blanc il ne s’exprime qu’en ce qu’on appellerait vulgairement du “petit-nègre”. Une langue et stratégie de communication tout à la fois qu’il enseigne à ses enfants afin qu’ils ne donnent jamais l’impression d’être supérieurs aux Blancs. Comme aujourd’hui, nombre de parents noirs-américains enseignent à leurs enfants la manière de se comporter en cas de contrôle de police (“On gagne toujours à donner aux Blancs ce qu’ils veulent”, pense Jim). De fait, sous la plume d’Everett, l’esclavage devient un théâtre auquel tout le monde fait semblant de croire : les Noirs jouent leur rôle d’esclaves gentiment abrutis et on ne sait trop si les Blancs y croient ou font semblant de. Car on voit bien que le Jim d’Everett, pardon, son James (qui ne s’est pas encore “choisi un nom”), est d’emblée libre. Au moins dans sa tête. Affranchi par nul autre que lui-même et sa soif de savoir.
James – Percival Everett, éditions de l’Olivier, 288 p., 23,5 €.