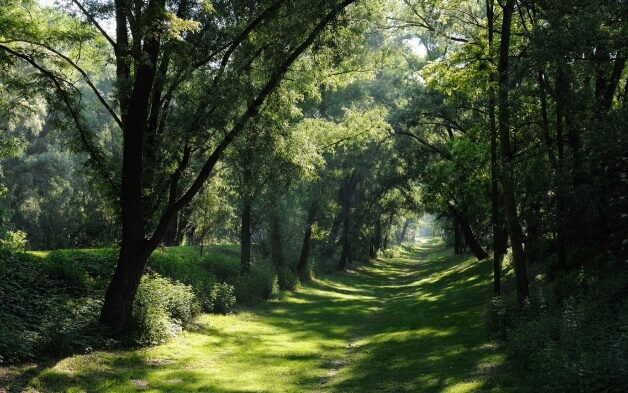Depuis leur arrivée au pouvoir en juin 2020, les écologistes lyonnais ont profondément changé le logiciel urbain. Exit la “signature”, la “starchitecture”, l’exception architecturale. Place à l’usage, à la sobriété et à une forme de banalité assumée. Les projets urbains de la Mairie et de la Métropole, qu’il s’agisse de nouveaux bâtiments ou de réaménagements d’espaces publics, bouleversent notre rapport à l’esthétique. Lyon court-il le risque de devenir “sans style” ? Les Lyonnais peuvent-ils se contenter d’un aplatissement esthétique ?
S’il y a un sujet qui fait parler en ville, ce sont les bancs en béton blanc installés cet été dans la partie nord de la rue de la République, au niveau des Cordeliers. Arrondis et positionnés en arcs de cercle, ils évoquent – au jugé – des formes pour le moins incongrues. Très vite surnommées “étrons”, “lombrics” ou “boudins”, ces assises massives cristallisent le débat sur l’aménagement urbain. L’autre exemple qui a fait couler beaucoup d’encre, ce sont les immenses voilages dressés place Bellecour au printemps dernier. Présentées comme une manière de créer de l’ombre et d’apporter un peu de fraîcheur, ces toiles suspendues ont surtout divisé. Certains y ont vu une installation légère et poétique, d’autres une gêne visuelle, presque une dénaturation de l’une des places les plus emblématiques de Lyon.
Là encore, la question posée est la même : jusqu’où l’aménagement temporaire ou fonctionnel peut-il avoir un impact sur l’image et l’esthétique d’un lieu symbolique ?

© Anaïs Lauvin
“Les goûts et les couleurs…”
“Ce sont des changements dans l’espace public, un temps d’acclimatation est nécessaire pour les gens”, est convaincu Fabien Bagnon, vice-président écologiste de la Métropole de Lyon chargé de la voirie. Les critiques sur l’esthétisme des bancs, fabriqués en Espagne et achetés par la Métropole à un fournisseur de Rillieux-la-Pape, il les balaie d’un revers de la main : “Les goûts et les couleurs, ça appartient à chacun. Il faut prendre un peu de recul et on verra dans quelques mois si les Lyonnais se sont appropriés ces nouveaux espaces.” La réalité voulant que nature ait horreur du vide, les gens s’assoient naturellement sur les bancs de la rue de la Ré ou sous les “ombrières” de Bellecour. “Le beau est une notion plastique, culturelle et sociale, poursuit François Duchêne, urbaniste, géographe et chercheur à l’École nationale des travaux publics de l’État, basée à Vaulx-en-Velin. Ce qui est beau pour les uns ne l’est pas pour les autres.”
Le beau, dès qu’il s’agit d’architecture ou d’urbanisme, suscite de fait toujours une certaine méfiance. Quand il ne s’agit pas tout bonnement d’un sujet tabou. Et pourtant, de beauté, il en est presque quotidiennement question dans les journaux ou sur les réseaux sociaux. “Les dénonciations de la prétendue décadence esthétique (…) est un véritable lieu commun, que l’on retrouve à toutes les époques”, rappelle Chloë Voisin-Bormuth, ancienne directrice de la recherche de La Fabrique de la Cité, un think tank des transitions urbaines.
De l’ombre à la lumière
L’aménagement urbain a toujours été un enjeu politique de premier plan et l’esthétisme de la ville l’une des conditions du fameux vivre-ensemble. Michel Noir l’avait parfaitement compris. 1989 est considérée comme l’année charnière du changement symbolique, sociologique et politique de la ville. Noir travaille sur une autre trajectoire, propose un projet urbain différent, avec l’idée d’améliorer la qualité de vie des habitants et de faire rayonner Lyon à l’international. Ce qui change la ville, c’est la mise en lumière de trois cents bâtiments. Sous cette même mandature, le plan Lumière – une première en France – transforme la ville terne et sombre en belle de nuit, modifie et redore l’image que la ville donnait d’elle-même. Michel Noir a eu l’idée d’illuminer les ponts pour embellir Lyon depuis son jardin à la Croix-Rousse où il contemplait “la traînée noire du Rhône la nuit”. “Contrairement à ce que Francisque Collomb disait il y a quarante ans, mettre en lumière une ville, ce n’est pas une dépense mais un investissement”, explique Alain Guilhot, concepteur du plan Lumière. La lumière n’est plus pensée par son prisme historique sécuritaire mais devient un matériau proprement dit et une véritable composante d’urbanisme. Elle permet une nouvelle lecture de la ville et transforme la vie nocturne des habitants.
Embellissement et starchitecture
Dans les années 90, Lyon bascule aussi, du point de vue de l’aménagement urbain, sous l’impulsion de son adjoint à l’urbanisme, Henry Chabert. La ville s’embellit, se ludifie.
“Lyon est une ville intéressante dans les années 90, concernant l’aménagement des espaces publics, des parcs et des jardins. Lyon devient alors une ville en pointe. Les paysagistes viennent voir ce qui s’y passe. Il y a une véritable politique qui est menée dans le centre historique et dans une partie des banlieues. C’est une politique systématique et qualitative. On fait appel à des gens connus comme les paysagistes Michel Corajoud (Cité internationale) ou Michel Desvigne (place des Célestins), les architectes Alexandre Chemetoff (place de la Bourse) ou Alain Sarfati (rue de la République)”, expose Valérie Disdier, historienne de l’art et urbaniste de formation. Ce sont ces exemples d’aménagement de l’espace public qu’on vient voir de toute l’Europe. Lyon pèse alors véritablement sur la scène européenne urbanistique.
Dans les années 2000, c’est l’ère de la “starchitecture”. “Ce recours à la starchitecture se finalise avec le musée des Confluences, de Coop Himmelb(l)au, qui met en œuvre la mimétique du Guggenheim à Bilbao”, explique Isabelle Lefort, professeure de géographie à l’université Lyon 2. “L’élément architectural constitue un outil permettant aux villes de se démarquer internationalement et de trouver une place dans la mondialisation”, écrivent la géographe Maria Gravari-Barbas et l’architecte-urbaniste Cécile Renard-Delautre*.
Lyon a connu vingt années durant lesquelles l’affirmation des métropoles passait par un travail très ostensible sur l’esthétique et le design, en particulier sur l’architecture et les espaces publics.
* in Starchitecture(s) : figures d’architectes et espace urbain, 2015.
Les “signatures” de Lyon, selon Raphaël Michaud, adjoint à l’urbanisme à la Ville de Lyon



Retour de l’usage
“Aujourd’hui, explique le géographe lyonnais Michel Lussault, on passe d’une fabrique de la ville basée sur l’image à celle fondée sur l’usage. L’usage revient en force pour deux raisons. D’une part, une critique des résultats de vingt-cinq ans de métropolisation : on avait promis des villes plus agréables, inclusives, ouvertes et on s’est retrouvé avec une flambée des prix immobiliers, des embouteillages, des nuisances, des inégalités sociales, de la violence et un délabrement des équipements publics. D’autre part, depuis une quinzaine d’années, on trouve dans la nature et les écosystèmes une source du beau et du bien-être : retour du végétal, biodiversité, substitution de zones automobiles par des zones de contact avec la nature.” Et de chercher à savoir si la nouvelle esthétique ne serait pas de se demander si “le bon critère pour juger du beau pourrait être le bien-être” ? Avec cette idée que chaque période fait naître un cadre intellectuel sur la question de l’esthétique urbaine. “La ville doit s’adapter à son époque, aux enjeux environnementaux – qui voudra encore y habiter s’il fait 50 degrés ? – et ne pas rester figée”, pense Eric Sainero, architecte-conseil de la Métropole de Lyon.
Nouvelle grammaire
La vague verte a balayé Collomb et son héritage. Dans les rues, ce n’est plus seulement la politique qui s’est transformée. C’est aussi notre regard. Les écologistes ont imposé une autre grammaire visuelle. Sobriété, usage, rejet de l’objet et de la monumentalité. Et l’idée d’une “ville apaisée”. La petite musique : Lyon a changé de paradigme et la beauté cesse d’être un objectif en soi n’a jamais autant résonné. “L’impression est celle que le beau ne nourrit pas, confesse, sous anonymat, un architecte en vue à Lyon. L’esthétique n’est plus un critère, elle passe au second plan. Avec pour résultat, une ville sans aspérités. On pourrait y voir une référence à Adolf Loos, qui s’opposait à l’ornement, vu comme un archaïsme bourgeois, inutile et barbare qu’il fallait supprimer.”
Sur le volet urbanisme, Raphaël Michaud, l’adjoint qui en a la charge, a fait le choix d’un “urbanisme favorable à la santé, avec notamment des ‘matériaux soins’, comme le bois ou le pisé, qui vont baisser la tension artérielle” et la défense d’une “architecture régénérative, plus simple, plus douce, plus terrestre”. Plus globalement, selon la formule de Nicolas Michelin, architecte-conseil de la Ville de Lyon, l’ordinaire extra remplace l’extra-ordinaire. “Fini les porte-à-faux, la recherche de déséquilibres. Je demande aussi aux architectes deux heures de soleil par jour dans les nouveaux appartements pour un minium de vitamine D.” Et de reconnaître que “quelque part, oui, on privilégie plus l’usage que le style”.
Lost in transitoire
Côté espaces publics, si Valentin Lungenstrass, l’élu à la Ville chargé de la question, défend la végétalisation comme “une nouvelle esthétique”, d’une manière générale, “la priorité est plus donnée à l’usage qu’à l’esthétique car beaucoup de nos projets sont transitoires”. “Le transitoire est presque un objet d’étude, relève-t-il, en cela qu’il permet d’observer les mésusages et les usages positifs, pour tirer les conclusions d’un projet pérenne.” Avec le danger, bien identifié, rappelle Chloë Voisin-Bormuth, que “l’engouement pour la pratique de l’urbanisme tactique ne doit pas devenir un prétexte pour un désinvestissement (…) à l’égard de l’aménagement de l’espace public”.
Et la place de l’artiste dans tout ça ? “Il y a eu un joli travail collaboratif entre artistes et enfants sur les abat-jour des lampadaires devant les écoles”, défend la Ville. Avant d’imaginer, dans l’hypothèse d’un deuxième mandat, une place spéciale accordée au street art dans les rues commerçantes, ou encore, comme à Séville, Madrid ou Barcelone, l’installation de toiles tendues entre deux immeubles en vue de créer des zones ombragées et rafraîchir les rues, “une autre façon de créer une nouvelle esthétique urbaine”.
Volonté politique
“Il n’y a, à Lyon, aucun parti pris esthétique fort, tranche Éric Jourdan, directeur de l’École supérieure art et design de Saint-Étienne. On est dans des solutions basiques, assez pauvres plastiquement. Ce n’est pas mieux à Grenoble. Globalement, la culture n’est pas un sujet qui intéresse les écologistes. Pourtant, l’esthétique ne doit pas être à la fin du budget. Et puis, à ceux qui disent qu’ils sont contraints budgétairement, je leur réponds qu’un objet bien dessiné ne coûte pas plus cher qu’un objet mal dessiné. On peut être moderne avec deux bouts de bois ; l’équation économique peut devenir un moteur de créativité. Il suffit d’une volonté politique.”
Le dérèglement climatique entraîne-t-il nécessairement un dérèglement esthétique ? Exit le choc esthétique, place à la sobriété verte ? Si Lyon se cherche une nouvelle identité, “plus que jamais le beau doit être au cœur de (ses) préoccupations”**.