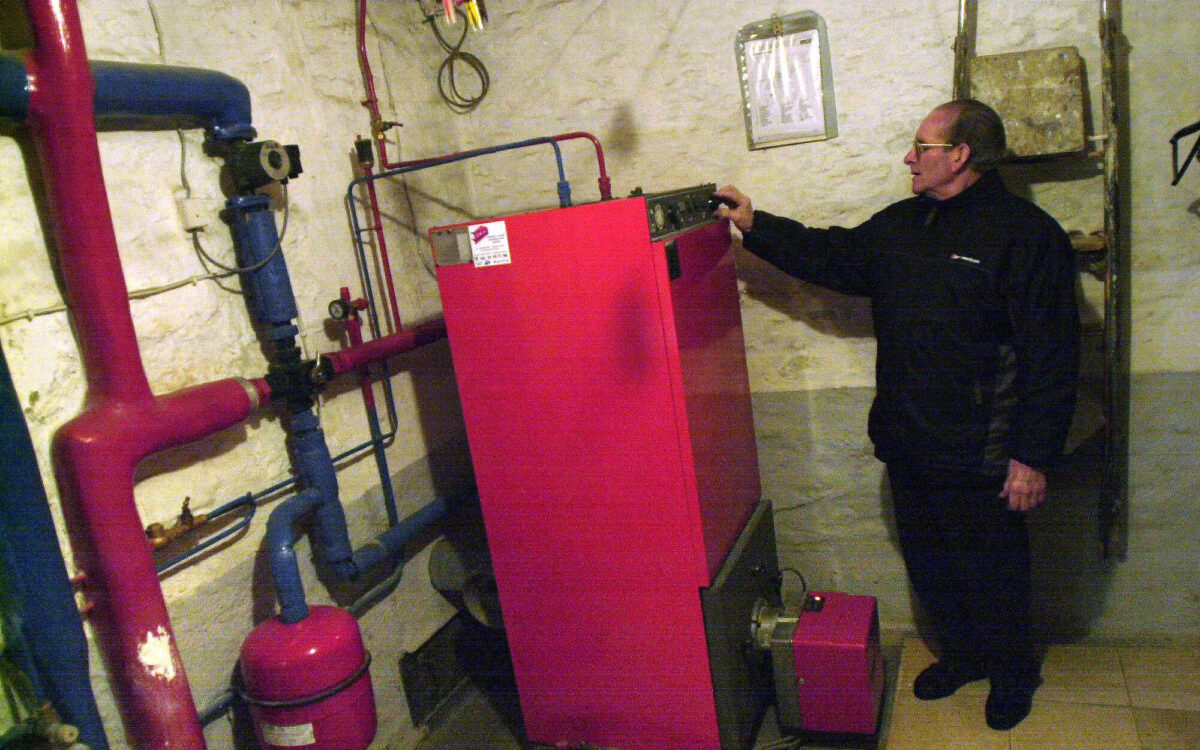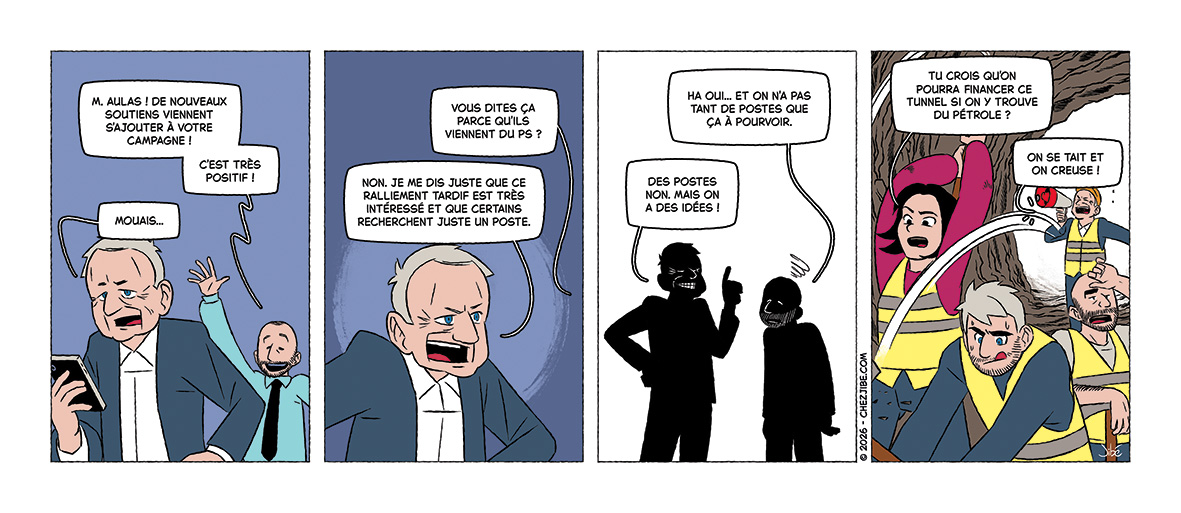Face à la flambée des prix de l’immobilier et à l’essoufflement du modèle de propriété individuelle, de plus en plus de Lyonnais se tournent vers une autre voie : l’habitat participatif. À la croisée de l’économie sociale, de l’écologie et du logement, Lyon est devenu le terrain d’expérimentation privilégié de ce nouveau modèle.
Est-on en train d’assister à la fin du modèle de propriété individuelle, pilier de notre économie basée sur le capital immobilier ? La question se pose devant l’émergence de nouveaux modes de propriété fondés, cette fois, sur la mise en commun de capitaux et de biens, et où les habitants partagent la propriété de leur logement. Concrètement, l’habitat participatif et coopératif, relégué aux expérimentations pendant les années 2000, séduit à présent de nouveaux ménages bien loin des stéréotypes altermondialistes parfois véhiculés autour de cette thématique.
Dans ce contexte, l’agglomération de Lyon fait figure de laboratoire à ciel ouvert. Avec plus d’une trentaine de projets aboutis ou en cours, soit plusieurs centaines de logements, la métropole lyonnaise compte la plus forte concentration de coopératives de France. Une place au sommet du podium souvent méconnue et qui s’explique par la présence historique d’acteurs pionniers. Parmi eux, Habicoop, la Fédération française des coopératives d’habitants, une association créée dès 2005 qui a lancé le “Village Vertical” à Villeurbanne, considéré comme le premier immeuble coopératif de France. Ouvert en 2013, il réunit une dizaine de ménages dans un bâtiment écologique et autogéré. Et les résultats sont déjà tangibles : grâce au principe de non spéculation, on estime ainsi que les loyers sont aujourd’hui 30 % moins chers que ceux du marché libre avec les mêmes prestations.
Sur la place de Lyon dans ce domaine, “c’est à la fois un concours de circonstances et une conséquence logique”, nuance Valérie Morel, présidente fondatrice de Cap Habitat Coopératif, ancienne salariée de Habicoop, qui accompagne et facilite la création de coopératives d’habitants en Auvergne-Rhône-Alpes et ponctuellement sur le territoire national. Pour elle, en plus de la présence d’acteurs locaux, l’avant-gardisme lyonnais s’explique également par la proximité avec la Suisse, où le modèle prospère déjà depuis le XIXe siècle. Par exemple, la ville de Zurich compte aujourd’hui 120 coopératives, soit plus de 60 000 logements, gérant au total un quart du parc locatif de la ville. Enfin, tous les observateurs soulignent la constance du soutien politique sur plusieurs générations d’élus lyonnais, depuis les débuts de l’ère Collomb et jusqu’à nos jours avec la majorité écologiste. Concrètement, l’action publique implique les coopératives dans plusieurs programmes d’aménagement en cours de chantier (Zac des Girondins, la Saulaie…) à travers des appels à projets ou des réserves foncières, et endosse le rôle de garant auprès des banques sous réserve que des bailleurs sociaux s’engagent à racheter les logements sociaux de la coopérative en cas de nécessité.
Lire aussi : "L’encadrement des loyers continue d’exister à Lyon et Villeurbanne" : Renaud Payre rassure les locataires
Solidaire, écologique et non spéculatif
Sur le fond, quel est le concept ? Des citoyens se regroupent dans une coopérative qui devient l’outil à travers lequel collectivement ils achètent, construisent ou réhabilitent et gouvernent un parc de logements. Autrement dit, les habitants ne sont pas propriétaires de leur appartement mais de parts sociales de la coopérative, société qu’ils gèrent et à laquelle ils doivent une redevance mensuelle, généralement de 15 % à 30 % en dessous des loyers du marché libre, qui permet de payer les charges liées aux logements, les mensualités de l’emprunt de la société et parfois de constituer “une épargne de secours”. Ce loyer, fixe dans le temps, est lié aux charges réelles de la coopérative, non au marché locatif.
En contrepartie, les habitants participent à l’élaboration de leur logement, choisissent l’architecture, le projet de promotion, les espaces communs (buanderie, jardin, chambre d’amis, ateliers), habitent ces logements et décident des orientations de la société. Selon les modèles, le ticket afin d’entrer au capital de la coopérative se situe entre 100 euros et 30 000 euros par ménage. L’équilibre financier est rendu possible grâce à un agrément donné par l’État permettant à la coopérative d’emprunter des fonds bancaires dans les mêmes conditions qu’un bailleur social. Autrement dit, avec des prêts sur quarante ou cinquante ans aux taux du Livret A, les dispositions sont bien plus favorables que lorsqu’un particulier négocie avec sa banque, soumis à un taux autour de 3 % pour une durée de vingt-cinq ans maximum.
Une approche en rupture avec le modèle du logement conçu comme un investissement qui prend de la valeur dans le temps. De fait, les apports varient selon les capacités de chacun et les coûts sont mutualisés. De plus, les projets défendent un principe de non spéculation. Ainsi, lorsqu’un occupant quitte la coopérative, il ne vend pas son logement mais demande le remboursement de ses parts sociales à la société, et le logement demeure dans la coopérative.
Lire aussi : Reprise fragile de l’immobilier à Lyon, selon la FNAIM du Rhône
Symptôme d’une crise sociale ?
Il vous reste 54 % de l'article à lire.
Article réservé à nos abonnés.