Lyon Capitale s'est entretenu avec l'écrivain Sorj Chaladon , dont Lyon est la ville natale. Le théâtre de son enfance brisée aussi, sous l’autorité d’un père mythomane et violent.
Sorj Chalandon a eu plusieurs vies. Grand reporter pendant plus de trente ans, il a couvert des guerres (Irlande du Nord – reportages pour lesquels il a été distingué du prix Albert-Londres –, Liban), de grands événements historiques (le procès Barbie). Il est aujourd’hui écrivain, auteur de douze livres parus chez Grasset, dont certains ont remporté des prix prestigieux, comme Une Promesse, prix Médicis, Retour à Killybegs, grand prix de l’Académie française, Le Quatrième Mur, prix Goncourt des lycéens. Lyon est sa ville natale. Le théâtre de son enfance brisée aussi, sous l’autorité d’un père mythomane et violent. Il raconte son “Lyon à moi”, et ses refuges, à Gadagne, autour de Guignol, et la bibliothèque Saint-Jean.
Lyon Capitale : Êtes-vous une grande gueule ?
Sorj Chalandon : Pour moi, une grande gueule, c’est quelqu’un qui l’ouvre lorsqu’il ne faut pas l’ouvrir, qui parle haut et fort et de ce qu’il ne connaît pas. Je me méfie des grandes gueules qui heurtent, jugent, rabaissent et insultent. Si c’est une grande gueule dans ce sens-là, la réponse est non. En revanche, si c’est pour dire ce que j’ai à dire, oui, car je ne cache rien.
Notamment la colère, qui revient toujours dans vos romans. Est-ce un ingrédient qui a été indispensable à votre processus créatif ?
La colère a été l’un de mes moteurs depuis l’enfance. La colère contre le père, contre la vie, contre l’injustice, toutes font partie de ce que je suis et, probablement, de mon processus créatif. La colère a irrigué tout ce que j’ai pu faire en écriture journalistique ou en écriture littéraire.
L’enfance, la révolte, la haine de l’injustice, justement, sont au cœur de quasiment tous vos romans. Comme un écho à votre propre histoire ?
Si j’avais été élevé à Lyon par un monsieur radical-socialiste, amoureux d’Édouard Herriot, aimant et soucieux de l’éducation de ses enfants, j’aurais peut-être d’autres colères, mais pas celles-là. Ma colère, c’est une colère d’enfance, devant l’injustice d’avoir été élevé comme ça par cet homme-là, l’Autre, comme j’appelais mon père. Elle ne m’a jamais quitté. Je la porte comme un fardeau depuis la naissance, et non pas comme un flambeau.

“La littérature a un poids autre que celui de simplement raconter des histoires”
Petit garçon, vous faisiez l’école buissonnière pour aller retrouver la marionnette de Guignol, figure centrale de l’imaginaire lyonnais, au musée Gadagne. Avez-vous trouvé en Guignol, personnage de la colère – car il disait ce que les auteurs pensaient–, un miroir de ce que vous étiez ?
Mon Dieu que le musée Gadagne était poussiéreux, tout noir, magnifique. Et surtout, gratuit. Je devais avoir entre 12 et 13 ans, je n’étais manifestement pas à l’école, mais à aucun moment, jamais, un adulte ne m’a dit : “Ce n’est pas l’heure, tu devrais être en classe.” C’étaient des adultes complices de mon école buissonnière. Là, je savais que jamais je ne croiserais mon père. Gadagne a été un refuge. Au fond du musée, tout au fond, dans une petite pièce, il y avait Guignol, le Guignol d’origine de Laurent Mourguet. C’était moi. Dans mon souvenir, il était abîmé du côté des lèvres, du nez, etc. Souvent, longtemps, j’étais le front contre la vitre et je lui parlais. Comme j’étais extrêmement bègue lorsque j’étais enfant, c’était le seul qui ne se moquait pas de moi. C’était mon seul pote.
Guignol trône d’ailleurs dans votre bibliothèque… Il est une sorte d’ange gardien ?
C’est mon Lyon à moi. J’ai imaginé Gnafron et Guignol donner des coups de bâton à mon père. C’était mon rêve. Longtemps après, j’ai recherché des guignols à droite, à gauche, j’en ai acheté, j’en ai peint. C’est un peu comme si j’avais enlevé Guignol à mon enfance et que je le gardais tout près de moi. Mais il n’était pas soignant, il était plutôt accompagnant. Et quand il m’était arrivé d’avoir été battu ou insulté, je lui en parlais. Je ne voyais pas, ni dans son regard noir ni dans son maigre sourire, de mépris ou de moquerie, choses qui étaient partout autour de moi, place de Trion avec les copains, à l’école. Les gens se moquaient, mais lui non. C’était la seule personne en qui je pouvais avoir totalement confiance.
“Crier ‘CRS SS’, c’est nier la Shoah, c’est nier la Seconde Guerre mondiale, c’est nier la Gestapo”
Vous dites avoir fait un marché, signé un pacte avec les mots, parce que vous étiez bègue. Dans Le Quatrième Mur, le personnage central interdit à son ami de scander “CRS SS !” pour, écrivez-vous, “protéger l’intelligence”. Que voulez-vous dire ?
À mon sens, il y a trop de mots qui ne sont pas réfléchis, qui sont dits sans responsabilité. Protéger l’intelligence, c’est faire rempart autour de ce bien commun qu’est la réflexion. Crier “CRS SS”, c’est nier la Shoah, c’est nier la Seconde Guerre mondiale, c’est nier la Gestapo. Non seulement les mots ont une signification, mais ils ont aussi un sens. Et lorsqu’on est bègue, les mots comptent plus que pour les gens “normaux”. Chaque mot est douloureux, chaque mot compte. Tu dois les choisir avec beaucoup de soin, ils pèsent plus lourd. Quand j’étais petit, je suis allé cueillir de l’herbe rue du Commandant-Charcot, au pied de mon immeuble, et je me suis fait une décoction d’herbes. J’étais absolument sûr que, comme il y avait des herbes pour tout guérir, il y en avait sûrement une pour le bégaiement. Le lendemain, je me suis aperçu que je parlais de façon fluide. C’était la foi du charbonnier. Quand j’ai avoué à mes parents que j’avais bu une tisane d’herbes, ils ont ri. Je crois que mon frère aussi. Et je me suis remis à bégayer tout de suite. Quand on met toute sa foi dans quelque chose et que les autres se moquent, on perd cette force et on retombe.
Le chemin qui vous a conduit de la souffrance des mots à l’écriture a-t-il été naturel ?
Je pensais que l’oralité me serait interdite. Le seul moyen de m’exprimer, c’était par les mots. Mon style d’écriture est une sorte de style bègue : je ne peux pas me perdre dans des phrases longues, parce que j’ai peur de trébucher. C’est un rythme qui doit prendre les mots par surprise. Et il y a effectivement ce pacte avec les mots : je les respecte.
La bibliothèque Saint-Jean a aussi été un sanctuaire. La lecture a-t-elle été, en quelque sorte, un acte de résistance ?
J’étais en short, à une heure de désertion scolaire. Une bibliothécaire a vu mes bleus, mes chaussures un peu trouées. Elle avait compris et a mis entre mes mains L’Enfant, de Jules Vallès. En ouverture, ce monsieur, que je ne connaissais pas, écrit : “Je dédie ce livre à ceux qui ont été battus par leurs parents, maltraités par leurs maîtres…” Je me suis alors rendu compte que je n’étais pas tout seul. Je me suis rendu compte que la littérature avait un poids autre que celui de simplement raconter des histoires. Il y avait une cohorte d’enfants maltraités dans la littérature dont je faisais soudainement partie. Et je me sentais beaucoup moins seul.
“Le procès de Klaus Barbie a redonné de la chair à l’histoire. De la chair, des visages et des voix à des résistants anonymes et magnifiques”
Journaliste, vous avez assisté, pour Libération, aux débats du tribunal lors du procès de Klaus Barbie en 1987. Quelle première image gardez-vous de Klaus Barbie lors de son entrée au palais de justice de Lyon ?
“Il entre. Vieillard fantomatique en costume noir.” C’est la première ligne de mon article. L’homme qui entre est un prisonnier, voûté, la tête dans les épaules, qui a perdu de sa superbe. C’est une sorte de vieux moineau, le regard émacié, avec le col trop large, la cravate noire. On a beaucoup de mal à se dire que cet homme a été le chef de la Gestapo de Lyon. Il joue au vieux monsieur qui n’a rien à faire là. Par son attitude, par son visage, par son costume trop grand, il nous dit qu’il n’est pas Klaus Barbie. Ça saute aux yeux. Et quand le président lui demande de se présenter, il répond Klaus Altmann. La messe est dite, il niera.
Parmi les plaidoiries, quelle est celle qui vous a le plus marqué ?
Celle de Serge Klarsfeld et les quarante-quatre enfants d’Izieu. Maître Klarsfeld n’a pas plaidé, il a fait entrer les quarante-quatre enfants dans le tribunal en les citant les uns après les autres et, chaque fois qu’il le pouvait, en lisant une carte postale envoyée à leurs parents : “Cher papa, chère maman, je travaille bien dans la petite école.” C’était bouleversant. Comme je n’étais pas sûr que les enfants entreraient dans le tribunal, j’avais réalisé, avant l’ouverture du procès, un reportage sur la maison d’Izieu. Elle était dans son jus, intacte. Dans la petite école de la maison, au premier étage, il y avait encore les photos d’animaux que les enfants avaient mises au mur, leur petit calendrier de 1944 qu’ils avaient fait à la main. C’était à pleurer. Les quarante-quatre enfants d’Izieu sont entrés, tranquillement, doucement, et ils ont pris place sur les bancs de la partie civile, sur les bancs des victimes. Pour moi, ça a été le moment le plus immense.
Qu’est-ce qui a changé en vous après ce procès ?
Ce n’est pas que ça a changé quelque chose, c’est ce que ça a renforcé. Ce que j’ai trouvé précieux dans ce procès, c’est qu’on entendait les voix des derniers témoins de la déportation, des tortures, de la résistance, de la Shoah. Ils comparaissaient devant nous, pour nous, pour la justice. C’était tellement violent et tellement fort. J’avais déjà couvert des procès, lu beaucoup de choses sur la guerre et la déportation. Mais là, c’étaient des voix, les dernières voix fluettes de ceux qui, souvent, n’avaient rien raconté. Il y avait des gens qui témoignaient sans jamais avoir parlé à leurs enfants ni à leurs petits-enfants. Et à Lyon, tout ce qui devait être dit avant qu’ils ne disparaissent a été dit. Ce procès a redonné de la chair à l’histoire. De la chair, des visages et des voix à des résistants anonymes et magnifiques. J’ai un souvenir bouleversant d’une vieille dame juive, rescapée de la rafle de la rue Sainte-Catherine, à Lyon. À l’époque, elle était une jeune fille avec de faux papiers, très mal faits. Elle savait que si elle se faisait contrôler, ça ne passerait pas. Place Bellecour, il y avait, d’un côté, une cohorte d’agents de la Gestapo et de la Wehrmacht et, de l’autre, quelques gardes mobiles français. Elle s’approche de ces derniers. Espérant. Parce que c’était la France. Elle donne ses papiers à un jeune garde, probablement de son âge. Il lit le papier, la regarde dans les yeux, regarde encore le papier, puis dit : “Allez, filez.” Qu’est-ce que c’est beau ! Et elle a dit : “On connaît Jean Moulin, on connaît les héros. Mais ce jeune garde mobile qui me dit : ‘Allez, filez’, personne ne connaît son nom. Et pour moi, c’est un héros.” Ce procès a permis de faire revivre aussi ces héros du quotidien.
“La fiction me permet de faire un pas de côté, de dire autrement ce que je ne peux pas exprimer dans un article”
Comment le journalisme a-t-il contribué à façonner l’écrivain que vous êtes devenu ?
Le journalisme m’a permis d’aller dans des endroits où je ne serais jamais allé. C’est grâce au journalisme que je suis parti en Irlande pour la première fois, que j’ai été correspondant de guerre pendant plus de vingt ans, que j’ai pu m’embarquer sur des chalutiers en Bretagne. Le journalisme m’a ouvert des portes, des lieux, des vies qui m’auraient été interdits. Mais il m’a aussi frustré car, pour moi, un journaliste ne doit pas dire “je”. Quand, en 1982, j’étais dans les camps de Sabra et Chatila, au Liban, je pleure, mais je ne peux pas écrire mes larmes. Les gens ne paient pas pour lire un journaliste qui pleure. J’écris donc un article glacial, sobre, grave. Mais quand je rentre, que je pue la mort, que j’ai ces images en tête, j’en fais quoi, moi, l’homme ? C’est pour me laver de ça que j’ai commencé à écrire des romans. Contrairement à ce que certains pensent, le sujet n’est pas que le roman dit ce que le journalisme ne peut pas dire. Non. Le roman me permet de dire “je”. Je revisite des vérités vécues mais transformées par la fiction.
Ce qui frappe dans votre œuvre, c’est à quel point fiction et réalité s’entremêlent. Vos romans sont nourris d’éléments biographiques. Est-ce que la fiction peut devenir un moyen d’approcher une vérité que le journalisme ne pourrait saisir intégralement ?
Je ne crois pas. À part le fait que je peux dire “je”, et que je laisse mes larmes couler dans le roman, le reste est identique. Les images, la construction, les sons, les silences. Je tiens à la vérité historique. Le journaliste que je suis empêche le romancier d’écrire n’importe quoi. Tous mes romans viennent de quelque chose que j’ai vécu : la violence du père, la guerre, la trahison en Irlande, le cancer. Je tourne autour de ça. Ce n’est pas de l’invention pure. C’est un masque, un prénom différent, mais c’est moi quand même. La fiction me permet de faire un pas de côté, de dire autrement ce que je ne peux pas exprimer dans un article.
Avez-vous besoin d’être cru pour écrire ?
Non. Parce que ce que je raconte est su. Je ne cherche pas à être cru dans mes romans. Ce qui compte, c’est que le journaliste soit cru. Et pour ça, je suis très attaché à l’exigence du métier. Je déteste les journalistes approximatifs, les bidonneurs. C’est pour ça que le journaliste qui est en moi ne laisse pas le romancier tricher.
Quel regard portez-vous sur ce qui se passe actuellement au Proche-Orient ?
Il n’y a plus aucune réflexion, plus rien. J’étais fou de rage contre les gens qui exigeaient la libération des otages, point. Fou de rage contre ceux qui exigeaient l’arrêt des bombardements, point. Ce qu’il fallait, c’était demander la libération des otages et l’arrêt des bombardements. Quand on ne demande que la libération des otages, on se fout des bombardements. Quand on ne demande que l’arrêt des bombardements, on se fout des otages. C’est dégueulasse. Soit on exige les deux, soit on se tait. J’ai rarement entendu, même dans les manifestations de gauche : “Cessez les bombardements et libérez les otages.” Ça me bouleverse. Moi, je viens de mouvements d’extrême gauche, des années 70. Tous nos chefs criaient “Palestine vivra” et tous étaient juifs : Alain Geismar, Alain Krivine… La Palestine, c’était comme le Vietnam. Il n’y avait rien de sacré, de religieux. C’était une guerre de libération nationale. Aujourd’hui, quelqu’un qui dit “cessez les bombardements” est traité d’antisémite, et quelqu’un qui dit “libérez les otages” est soupçonné d’être un sioniste messianique. C’est absurde. Les deux doivent être criés ensemble. Faire la paix, c’est s’asseoir avec le salaud en face. C’est ça faire la paix. Tant qu’Israël et le Hamas – ou ce qu’il en reste – ne s’assoient pas à la même table, rien n’est possible. Moi, je viens d’un monde où on pouvait dire “Israël doit vivre” sans être traité de sioniste de merde et dire “les Palestiniens doivent avoir un État” sans être traité de terroriste pro-Hamas.
“Quand on met toute sa foi dans quelque chose et que les autres se moquent, on perd cette force et on retombe”
Quel a été le meilleur conseil que l’on vous ait donné ? Et celui que vous donneriez ?
Écouter avant de parler. Écouter et apprendre de l’autre. Quand Libération m’avait demandé de couvrir l’invasion du Liban par Israël en 1982, Serge July m’avait dit : “Je ne veux pas que tu arrives chez les Palestiniens avec un seul point de vue. Tu vas d’abord en Israël, tu prends des obus palestiniens sur la tête. Et ensuite, tu vas de l’autre côté.” C’est une intelligence incroyable. Tant que tu n’as pas partagé les deux peurs, tu ne mesures pas. C’est la même chose en Irlande. J’étais trop avec les républicains irlandais. Un jour, ils m’ont dit : “Va en face. Va comprendre la peur des protestants. Si tu ne comprends pas leur peur, tu ne comprends rien.” Nier une peur, c’est faire la guerre.
Avez-vous des regrets ?
Oui. En ce moment, j’ai deux regrets. Deux reportages que je n’ai pas faits et que je regrette profondément. J’aimerais être à Gaza avec les Palestiniens. Et j’aimerais être avec les jeunes juifs des collines, ces colons qui s’en prennent aux Palestiniens, à leurs maisons, à leurs oliviers, à leurs vieux, qui les agressent. J’aimerais comprendre la peur des Gazaouis, l’écrire. J’aimerais comprendre la haine des jeunes colons, la décortiquer. Je suis obligé, comme tout le monde, d’écouter la radio, de lire les journaux. Mais ça ne me suffit pas. Je ne peux comprendre les choses que si je suis sur place, au plus près. Sinon, j’aurai toujours le commentaire du journaliste avant le fait. Et moi, je veux le fait, pas ce qu’en dit un général retraité à la télé ou un expert de plateau.
Pour reprendre le titre d’un film français, finalement, vous avez toujours eu le goût des autres…
Toujours. C’est mon essence. Je viens d’un homme, mon père, qui n’avait que le goût de lui-même. Un jour, dans la voiture, au début des années 60, il fait une remarque, je ne me souviens plus quoi. Il me regarde dans le rétroviseur, moi j’étais à l’arrière, et il me dit : “Écoute Sorj, je vais te dire un truc. Il faut que tu t’en souviennes toute ta vie : les gens sont cons.” Voilà. Je viens de là. Et moi, j’ai appris que non. Les gens, il faut les écouter, leur parler, les instruire si possible. Je viens de là. Et depuis, j’ai appris à les connaître




 Municipales à Lyon : le tableau de chasse de Jean-Michel Aulas
Municipales à Lyon : le tableau de chasse de Jean-Michel Aulas 















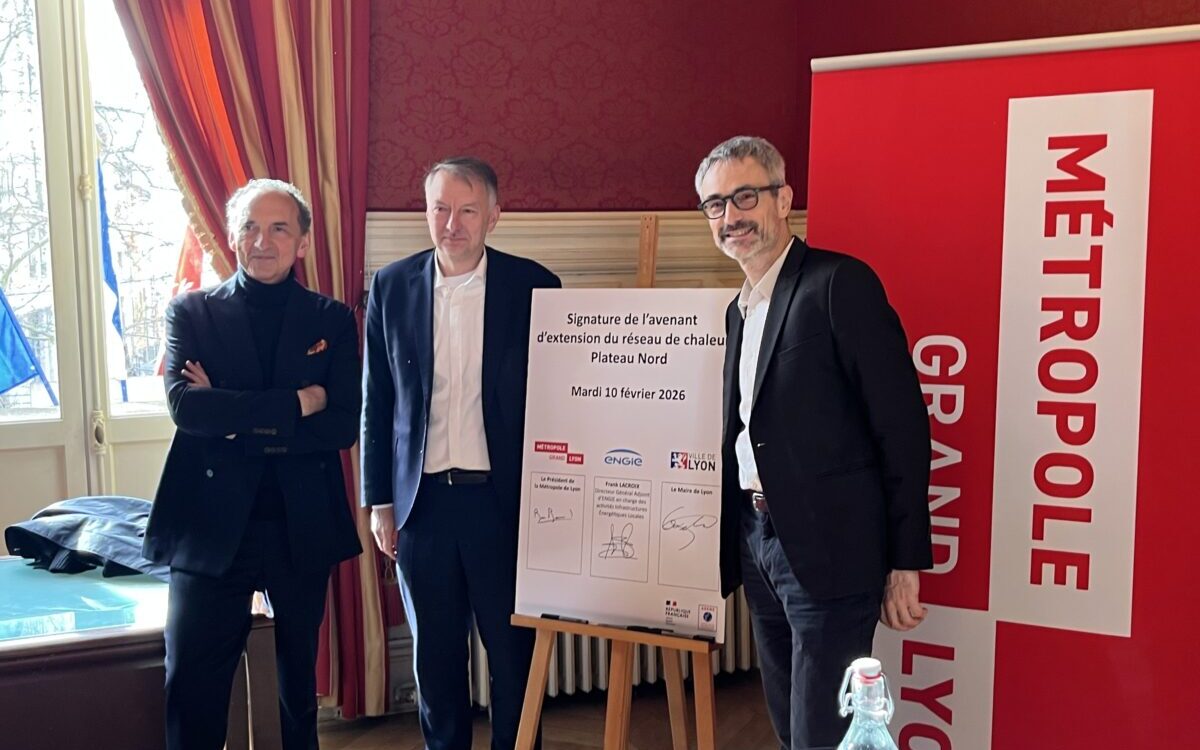



Comprendre la mécanique de la violence... pour éviter sa naissance ou du moins sa croissance...
Si un jour cet auteur est intéressé, qu'il n'hésite pas à regarder ce qu'en disent les postmonétaires sur le site du collectif lyonnais.
Pouvez vous corriger dans les 3 lignes de présentation en haut d'article ?
C'est Chalandon, et pas Chaladon.
J'ai toujours admiré ce Monsieur pour la qualité de ses articles de grand reportage dans Libération.
Il a raison ne jamais manger avec un membre de la meute même avec une longue cuillère !