La Biennale d’art contemporain est inaugurée à Lyon ce mercredi par la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti. Pour Lyon Capitale, Gunnar Kvaran, son commissaire islandais, et Thierry Raspail, son directeur, expliquent leurs choix dans cette édition 2013.
Thierry Raspail, directeur du musée d’Art contemporain de Lyon et de la Biennale, et Gunnar Kvaran, directeur du musée d’Art contemporain Astrup Fearnley d’Oslo. Invité à prendre les commandes de cette 12e biennale, il vient clore la trilogie placée sous le thème de la transmission.
-----
Lyon Capitale : Qu’est-ce qui a motivé votre choix de collaborer avec Gunnar Kvaran pour cette 12e biennale ?
Thierry Raspail : Après Hou Hanru et Victoria Noorthoorn, je voulais quelqu’un qui ne soit pas un spécialiste des biennales. Gunnar est directeur d’établissement, donc il a un programme, et il est, depuis une dizaine d’années, à la pointe de l’actualité, à travers des recherches sur plusieurs années dans des pays où il se rend systématiquement. Il s’est signalé par une très belle exposition sur la deuxième génération chinoise ; autour de l’Inde, il a fait quelque chose de formidable sur une scène qu’il a quasiment découverte aux Etats-Unis ; il prépare quelque chose sur le Brésil... Bref, il a vraiment une connaissance des grandes scènes.
Il avait deux autres atouts : il maîtrise le français, et sa position au nord de l’Europe est pleinement européenne et un peu en marge. Cette social-démocratie des pays nordiques à laquelle les Français aspirent et ses institutions se sont montrées extrêmement judicieuses (alors qu’elles ne sont pas plus riches que nous) dans le choix de certains artistes dès les années 1970, notamment américains, et ont de très belles collections, très sérieuses et pas “frime”. Le regard du Nord de l’Europe est à la fois dans l’Europe et en peu en dehors. Dans le cadre de ces biennales, on en avait tous tellement marre des États-Unis qu’on avait fini par dire que c’était le grand méchant loup. Sans savoir ce qu’il allait réaliser, je me suis dit que Gunnar allait oser aller aux États-Unis, en Occident, en Europe...
Gunnar Kvaran, quelle image aviez-vous de la Biennale de Lyon avant d’être invité à en assurer le commissariat ?
Gunnar Kvaran : Je connaissais bien la Biennale et son directeur, même si nous ne nous étions jamais rencontrés. Je suis depuis très longtemps le développement du musée et de la Biennale, et cette fusion entre les deux m’a paru une idée assez forte : elle permet de mettre le musée en plein dans l’actualité. Il a aussi donné une très grande autonomie à des commissaires-chercheurs professionnels de grande renommée, tout en ancrant la Biennale dans une réalité à Lyon, avec toutes les conséquences socioculturelles qu’elle peut dégager. Si on la compare à celles de Venise ou São Paulo, c’est une biennale artistiquement très forte, internationale et extrêmement ancrée dans la vie.
Vous dites avoir répondu quasi instantanément “récit” au thème de la “transmission” proposé par Thierry Raspail.
GK : En effet, j’ai répondu très spontanément “narration”. J’ai ajouté “mais pas n’importe comment”. Depuis très longtemps, je suis intéressé par la relation entre forme et contenu. Comme j’ai une formation d’historien d’art, notre recherche inclut souvent ces deux choses. J’avais aussi remarqué que malgré le fait que, depuis ces vingt ou trente dernières années, l’art est devenu plus conceptuel, que le discours autour de l’art est d’ordre plus philosophique, je percevais un intérêt croissant chez les jeunes artistes pour la narration et une volonté d’inventer de nouvelles formes. Un peu partout dans le monde.
Il y a d’ailleurs une majorité de jeunes, voire de très jeunes artistes (nés entre 1970 et la fin des années 1980), dans cette Biennale.
GK : C’est un parti pris. Il fallait d’abord définir ce qu’était une biennale. Venant du musée, je ne voulais pas faire une exposition historique. Je ne voyais pas comment faire une exposition convaincante sur l’histoire de l’art narratif, qui est là depuis le Moyen Âge.
TR : La première fois qu’une image précède une histoire, c’est Giotto en 1278 qui invente la légende de saint François. On ne peut pas remonter jusqu’à cette date !
GK : Oui, c’était impossible. En même temps, j’ai toujours pensé qu’une biennale devait dialoguer avec la contemporanéité et faire une sorte d’état des lieux de la création actuelle. J’ai eu envie de quitter le statut de directeur de musée et de proposer ma propre narration sur l’art narratif dans l’art contemporain. Je laisse l’histoire, mais je prends quelques éléments que je connais, et je fais croiser ma propre histoire avec la grande histoire. Par hasard, il y a quelques artistes qui ont déjà une position historique, comme Erró, Yoko Ono et Alain Robbe-Grillet, avec qui j’ai eu le plaisir et l’honneur de travailler. Pour structurer l’exposition, j’ai donc décidé de les inviter, comme représentants de la peinture, de la performance, du roman et du cinéma.
Ensuite, il y a une sélection d’artistes avec qui j’ai fait des grandes expositions et avec qui j’ai eu des dialogues créatifs. Avec les trois premiers, j’étais plutôt à l’écoute, l’humble serviteur ! Avec Matthew Barney, Jeff Koons, Fabrice Hyber ou Paul Chan, on entre dans une contemporanéité qui allait me donner les clés et les outils de travail pour définir et constituer une sélection d’artistes très jeunes.
---> Suite page 2
Y a-t-il eu débat sur les artistes sélectionnés par Gunnar Kvaran ?
TR : Je considère que c’est la biennale de Gunnar. Je suis là de temps en temps pour donner mon avis, être attentif au fait que tel artiste avait déjà exposé, ou définir quelle pièce serait la bonne. L’idée des trois actes (trois artistes historiques) est venue à Gunnar au fur et à mesure. Jamais je n’aurais pensé qu’Erró – qui passe quand même en France pour un peintre strictement politique, alors qu’il a d’une certaine manière révolutionné le discours en peinture –, que Yoko Ono – qui est pour nous l’égérie des Beatles, mais qui dans la performance a complètement révolutionné les choses – et enfin Robbe-Grillet, qui fait le lien entre la littérature et le film, pourraient former cette espèce de triangle.
Les discussions ont porté sur des questions du type : “C’est quoi la narration ?” “C’est quoi un récit visuel ?” “En quoi Jeff Koons raconte ?” Sur Jeff Koons, le réflexe en France est de se dire “voilà quelqu’un qui est l’otage du marché”, il est associé à des choses totalement négatives. Et je trouve vachement bien, quelles que soient les conséquences vis-à-vis du public, que l’on dise : “Non, on peut être sur un marché, coûter très cher et être un excellent artiste, ou coûter très cher et être nul, ou être hors d’un marché et être nul aussi.” Jeff Koons est tellement un symbole et un symptôme aujourd’hui que plus personne n’ose l’inviter dans les biennales. C’est devenu le diable, je trouve ça curieux. Moi, je suis très content de voir Koons à Lyon, une ville de gauche, qui a plutôt des sympathies pour l’humanisme en général. Est-ce qu’on va dire que Rubens était un salopard sous prétexte qu’il servait le roi ou qu’il était ambassadeur ? Oui et non, chacun gère avec les pouvoirs. J’étais persuadé que Gunnar aurait le courage de ne pas tenir compte des a priori.
En regardant dans le détail, il semble que vous ayez choisi des artistes qui ne font pas tant référence au cinéma ou à la littérature qu’à l’histoire avec un grand H, la culture populaire, les événements du monde, les faits divers...
GK : Quand on commençait à parler de structure narrative et de narration, les gens ne se référaient qu’à la littérature et aux films. Il y a d’ailleurs énormément d’écrits et une grande fertilité dans les discussions sur ce sujet depuis une quarantaine d’années. Nous n’étions pas en train de proposer la narration littéraire et pas du tout celle transmise ou transcrite en œuvres d’art. Nous parlions de récit visuel. Le récit visuel est régi par ses propres mécanismes et ses propres lois. Les artistes nous racontent des histoires et ils utilisent d’autres moyens. Ces artistes sont très souvent conscients de leur projet et verbalement très bien organisés, mais c’est l’œuvre avant tout.
Si je prends l’exemple de Matthew Barney, artiste américain qui invente des histoires comme le cycle Cremaster, je peux vous les raconter comme ça, mais la vraie histoire est celle que l’on voit dans son œuvre, en combinant de manière intelligente et visuelle une sculpture ou deux, des photographies, le film, des dessins et éventuellement une performance. Il propose un récit visuel qui peut introduire des notions que l’on ne trouvera jamais en littérature, comme le temps, l’espace, la sensualité de la matière.
TR : Pour le dire d’une autre façon, “structure narrative” est un truc très européen, presque français. Nous, on comprend que l’on peut découper un récit, l’organiser sous forme de structure. Lorsque l’on était au Japon, en Chine et en Corée et que Gunnar parlait de structure narrative, très souvent les artistes sortaient un film, parce que c’est la première chose qui leur venait. Le film pouvait être remarquable, mais il utilisait quasiment à tous les coups des codes cinématographiques très académiques, très conventionnels. Ça ne fonctionnait pas. On leur expliquait qu’il ne s’agissait pas uniquement de récit mais de la façon dont ce récit s’organise, c’est-à-dire que la forme de ce récit est aussi importante que le récit lui-même.
GK : Un artiste comme Paul Chan, qui réalise des vidéos projetées au sol, politiquement très engagé, a créé une narration en animation avec des ombres et des mouvements, mais la structure narrative ici réside surtout dans la façon dont il va transformer l’écran en fenêtre. Comme c’est un film qui porte sur la religion, cette transformation structurelle entre l’écran et la fenêtre prend une dimension tout à fait sémantique. La jeune génération d’artistes, enfants de l’Internet, développe d’autres possibilités de narration liées aux logiciels, aux capteurs de mouvements pour transposer des actions de la réalité dans une fiction, dessine et invente des histoires qui sont prolongées par des ordinateurs.
Comment le titre de l’exposition, presque un condensé de roman, vous est-il venu et que nous dit-il sur l’exposition que vous avez conçue ?
GK : Je ne voulais pas d’un titre classique, qui devrait nous expliquer le contenu de l’exposition. À la base, le photographe Roe Ethridge, invité à travailler sur l’identité visuelle de la Biennale, a proposé trois images : celle du jeune homme à l’œil au beurre noir, la fille un peu bourgeoise et le cochon. J’étais intéressé par le fait qu’il présentait une série d’images qui invitait déjà à un type de narration. J’ai donc voulu jouer de façon similaire en proposant trois titres, un par affiche. Mais trois titres pour ce genre d’événement risquaient d’amener de la confusion. Alors j’ai décidé de proposer un titre en trois parties.
“Entre-temps... brusquement, et ensuite” n’explique pas le contenu de l’exposition, ce n’est pas une sorte de métaphore de la Biennale, mais les mots peuvent ou doivent déclencher une narration. Ces mots, en relation avec les images, dégagent une narration parallèle à toutes celles qui seront montrées dans la Biennale.
Y aura-t-il une scénographie particulière pour chaque lieu ?
GK : De la même manière que je ne voulais pas un titre qui expliquerait le contenu de l’exposition, je ne voulais pas non plus créer une espèce de méta-narration dans l’exposition, ni de hiérarchie entre les œuvres. J’ai donc opté pour une scénographie assez neutre, démocratique, où tous les artistes de générations et continents différents se rencontrent dans une constellation d’œuvres d’art. Je voulais également inviter John Kelsey, qui représente pour moi le nouveau type d’artistes, à la fois grand intellectuel, artiste, mais aussi critique et commissaire d’exposition. Nous sommes encore en train de voir comment il peut intervenir dans la Biennale par une narration parasitaire. C’est une manière très actuelle de concevoir l’art. Pour l’instant, on ne sait pas encore ce qu’il fera, ça fait partie des surprises de la Biennale...
---
Cet entretien a été réalisé en juillet 2013 et publié dans le dossier Biennale du supplément Culture au mensuel Lyon Capitale n° 725.
-----
Entre-temps... brusquement, et ensuite – 12e Biennale d’art contemporain. Du 12 septembre au 5 janvier, à Lyon.




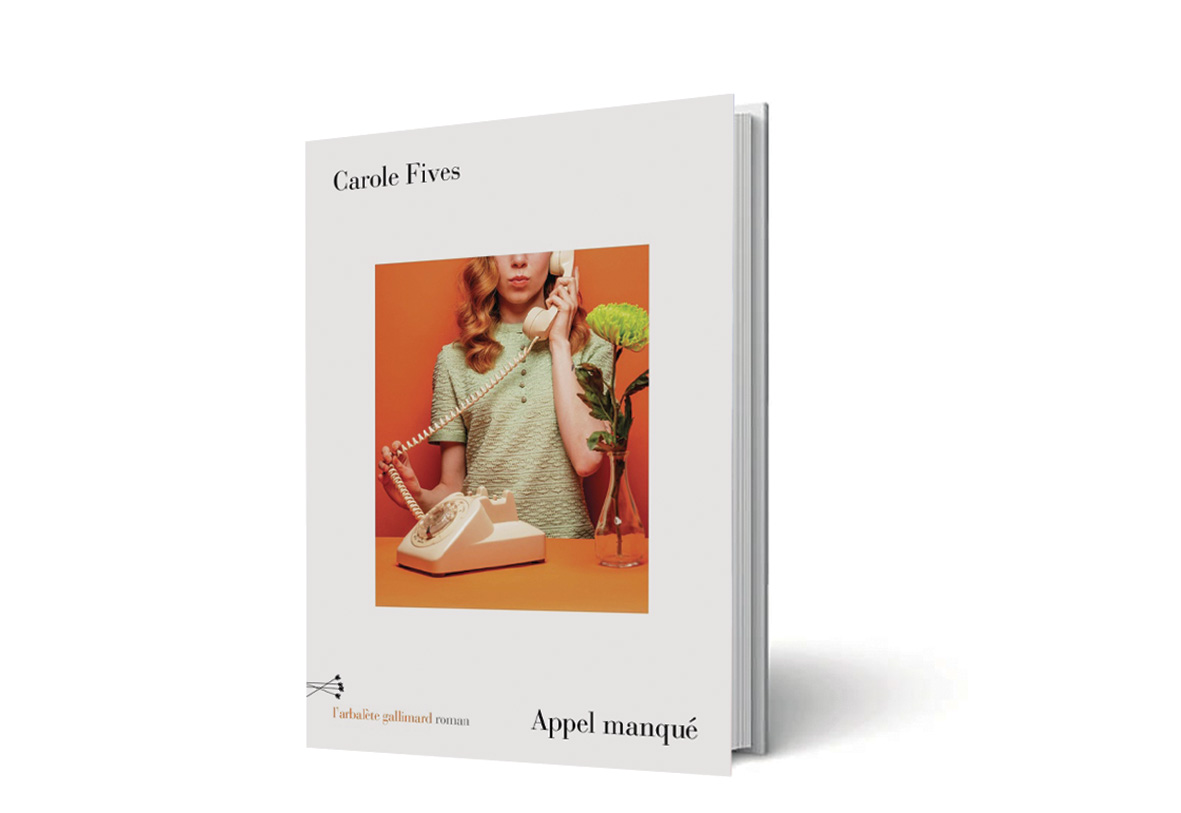





















Biennale d'art contemporain de Lyon dissidente activiste BAC OUT sous l'impulsion de l'artiste Lili-oto ; un autre regard sur l'art contemporain, la création contemporaine et les artistes plasticiens http://biennaleartcontemporain.over-blog.com/