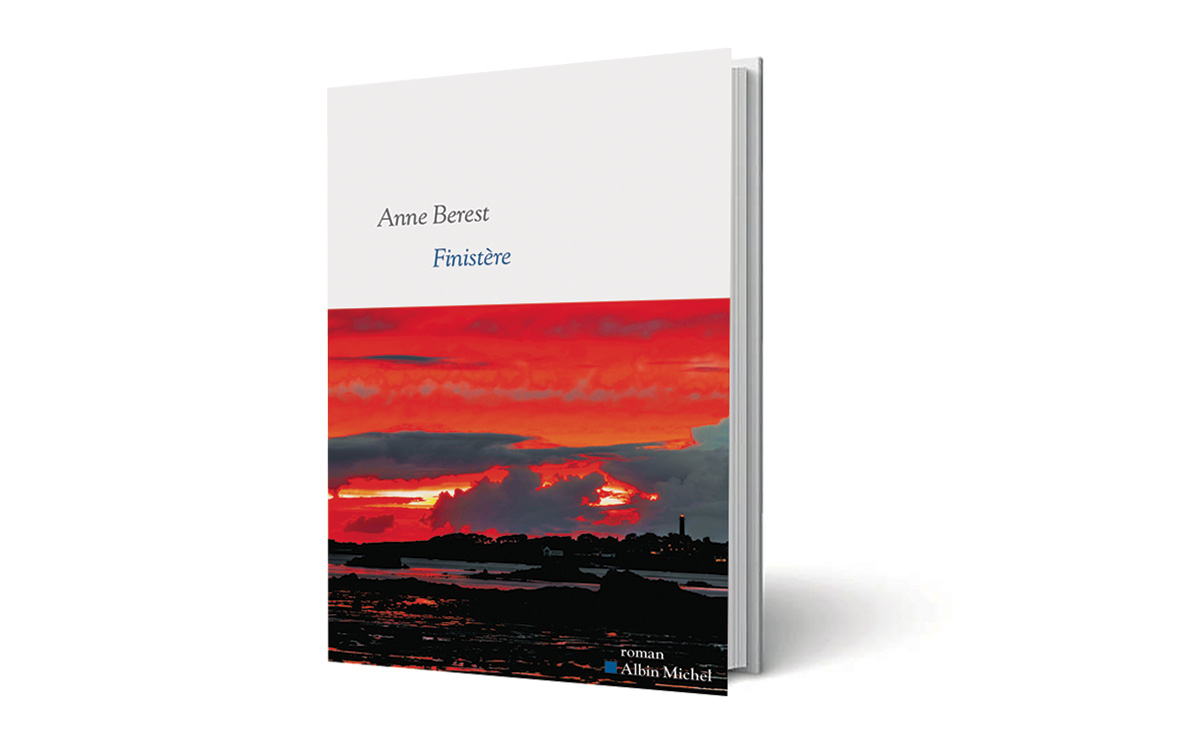Avec l'histoire (vraie) d'un randonneur qui se coupe le bras pour se libérer d'un rocher, Danny Boyle livre un film entre auto-caricature et auto-critique. Ramenard, tête à claque, agité, mais au final plutôt efficace.
A revoir les films de Danny Boyle, on pourrait rebaptiser le cinéaste anglais Usain Boyle, tant sa filmographie ((inégale) peut être analysée à l'aune de la course. Chacun de ses personnages est à un moment amené à courir. A sprinter, il s'agit ici d'adrénaline, pour fuir les conséquences d'un larcin ou la police (Trainspotting, Slumdog Millionnaire, Une Vie Moins Ordinaire), des zombies (28 jours plus tard), des trafiquants de drogue (La Plage) ou pour atteindre un but : la femme qu'on aime (Slumdog Millionnaire, Une Vie Moins Ordinaire), la fortune (Slumdog Millionnaire, Millions), le soleil (Sunshine) ou carrément soi-même (à peu près tous ces films). C'est que Danny Boyle voit la vie comme une sorte de trekking géant (il a d'ailleurs filmé un peu partout dans le monde), un jeu vidéo grandeur nature, où il s'agirait sinon de survivre, du moins d'atteindre une sorte d'extase totalement vaine qui pourrait être une (plus ou moins) petite mort avant le passage à l'âge adulte. "Choisir la vie", disait Trainspotting. De ce point de vue, 127 heures est plus que raccord. Il faudra d'ailleurs voir dans ce titre moins une durée qu'un compte-à-rebours de ce choix (la vie, donc). Aron Ralston (James Franco, amphétaminé) est un type qui court, il ne fait même que ça. Il voit la nature sauvage comme un immense terrain de jeu où grimper, rouler, sauter, courir. Après quoi ? On ne sait pas trop. Car dans la vie, ce touriste (autre figure boylienne) ne fait que passer. Jusqu'au moment où un foutu rocher d'un canyon de l'Utah, lui écrase le bras droit après une mauvaise chute. Le coinçant là, peut-être, pour toujours. 127 heures, une éternité. En réalité, Danny Boyle, le cinéaste, on le comprendra au gré de quelques flash-back sur Aron passant son temps à filmer les gens, est coincé là avec lui. Dans les décors mythiques du grand ouest et du western américain... à filmer un trou. Pris au piège du cinéma.
Into The Wild
Aron use alors de tous les moyens à sa disposition (cordes, lampe, poche à eau, couteau rudimentaire, et même caméra) pour se sortir de cette mauvaise posture, Danny Boyle aussi. En une sorte de cinéma sorti du sac, de film-couteau suisse, il fait étalage de son "tout à l'esbroufe" habituel : split-screens, couleurs saturées, onirisme psychédélique, bref, ce pourquoi on l'aime et le déteste à la fois. En réalité, il s'autocaricature en jeune hyper actif coincé au fond du trou, comme une mise en abîme de la perte d'inspiration et de tous les artifices pour, sinon la retrouver, du moins la masquer par des effets de manche. Car Aron se prend pour un super-héros. Et c'est lorsqu'il s'aperçoit que ce n'est pas le cas, qu'il en finit avec l'auto-complaisance et l'auto-satisfaction, qu'il devient ce héros, au prix d'une morale toujours un peu simpliste chez Boyle : "si tu n'étais pas si égoïste, tu ne serais pas autant dans la merde". On avait compris : Into the Wild de Sean Penn ne disait pas autre chose. En guise de rédemption, le jeune Aron maquille le hasard en destin avant de prendre, littéralement, les choses en main. Il acquiert alors ce qu'il faut d'inconscience et de courage pour se couper le bras (et aller boire un coup). C'est uniquement lorsque, arrachés à eux même, le randonneur et le cinéaste retrouvent leur liberté de mouvement, comme une renaissance, que Danny Boyle ménage enfin un suspense haletant au son du Festival du groupe islandais Sigur Ros. Car la course n'est pas finie... Aujourd'hui, Aron Ralston, le vrai, court toujours, un bras en moins. Quant à Danny Boyle, son prochain film devrait être la reprise de la franchise 28 jours... avec 28 mois plus tard. Une histoire de morts revenus à la vie et qui courent vite, très vite.



 Fête des lumières : les projets pour rallumer la flamme
Fête des lumières : les projets pour rallumer la flamme