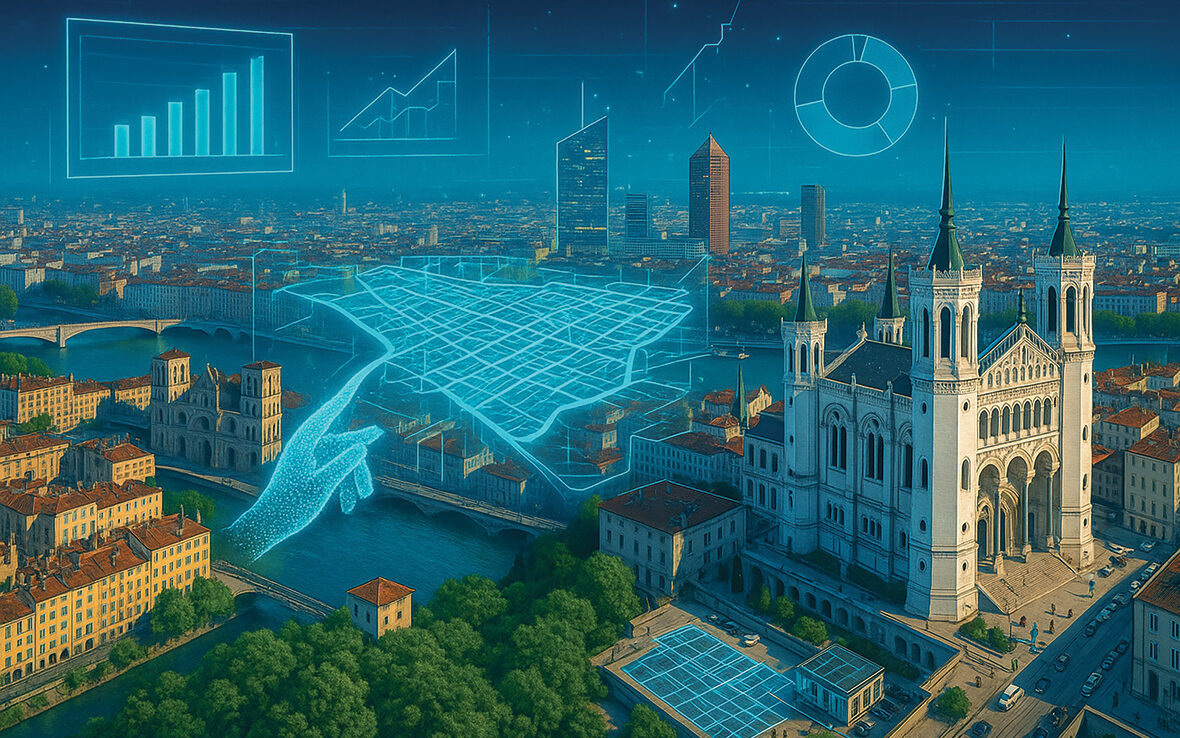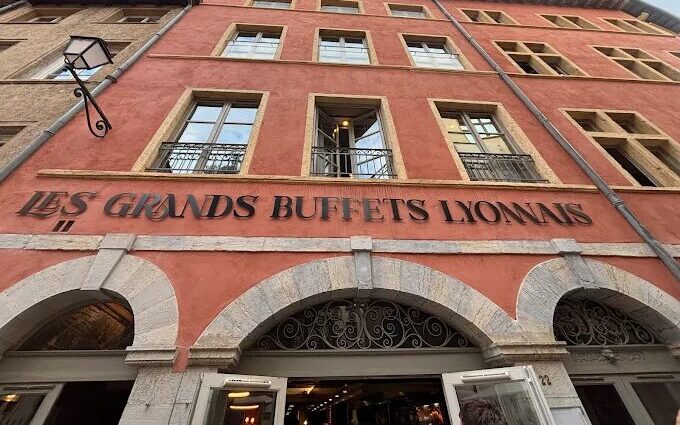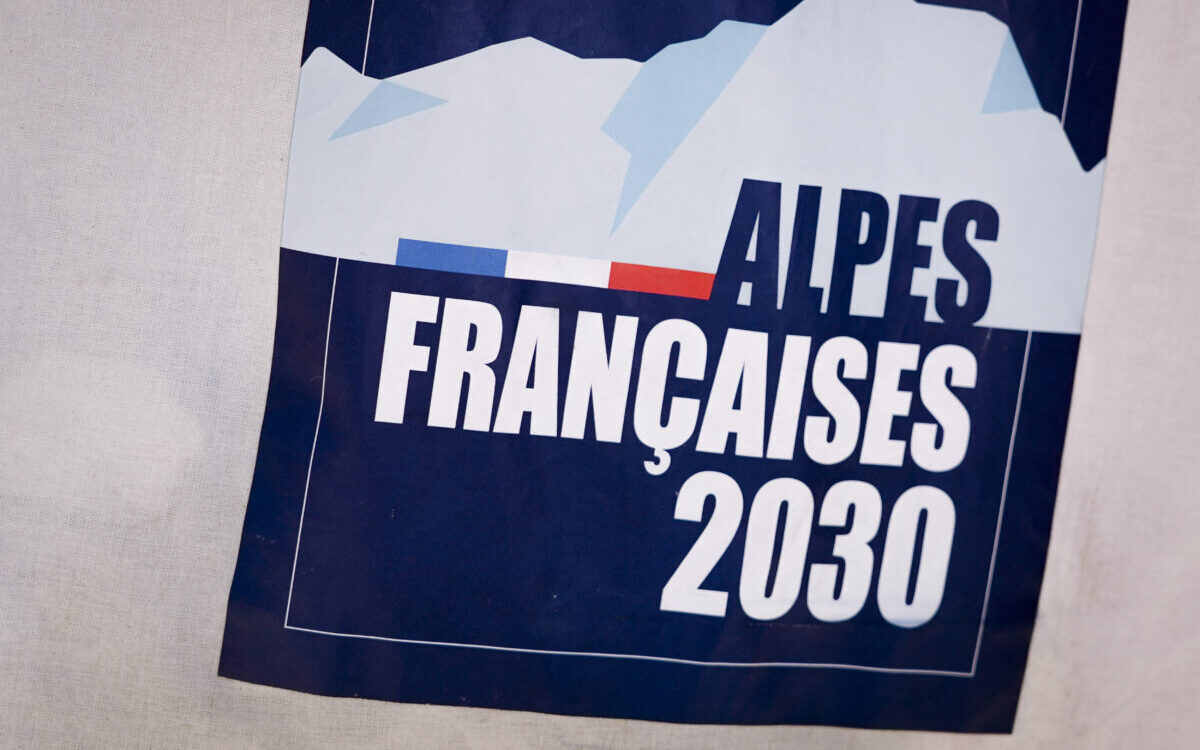Gilles Gesquière est enseignant-chercheur au Laboratoire d’informatique en images et systèmes d’information (Liris) d’Écully. Il co-dirige, pour le CNRS, le programme national de recherche “Ville durable”, dédié à (ré)inventer les villes pour habiter la France de demain.
Lyon Capitale : La cartographie est une partie intégrante de l’histoire de l’humanité. Des tracés à plat, on est passé à des modélisations dynamiques et interactives de la ville en 3D et en temps réel. Qu’apportent les données dans la planification urbaine ?
La donnée permet d’expliciter et de comprendre. Prenez l’exemple du ruissellement : le croisement des données de pente avec celles de l’occupation de sols peut aider à limiter ce risque. En y agrégeant des données de population, cela permet de déterminer les défis liés à la construction de certains types de bâtiments. La donnée joue un rôle déterminant dans la planification urbaine et offre des combinaisons infinies pour l’intelligibilité des enjeux de territoire.
On parle, depuis quelque temps, de “jumeau numérique”, réplique virtuelle d’un territoire. Est-ce une réalité à Lyon ?
La Métropole de Lyon a effectivement son jumeau numérique. Il faut voir le jumeau numérique comme une représentation du territoire, plus ou moins précise, en fonction de ce que l’on veut faire. Pour cela, on mobilise des données – géométrie et densité urbaine, emplacement et hauteur des bâtiments, conditions météorologiques, végétations, réseaux d’énergie et de transports, etc. –, des simulations et on visualise les résultats. Parce que la gestion des territoires est très complexe, avec de nombreux problèmes à gérer en même temps. Le jumeau numérique est précisément l’objet intermédiaire qui nous permet de réfléchir ensemble à toutes ces problématiques, en ayant des données en commun à partager pour penser le territoire. Cela nous permet de réaliser des modèles utilisant des données afin de mieux étudier les aléas et aussi d’expérimenter. Il faut garder en tête que la ville est un écosystème, dans lequel les systèmes se superposent. Un petit changement ici peut avoir un impact énorme sur le fonctionnement global. Dans la construction urbaine, il faut pouvoir comprendre les impacts indirects. Les données et les modèles peuvent aider à mieux anticiper les conséquences d’une décision. Planter un arbre a des conséquences sur les besoins d’entretien, le refroidissement urbain, l’imperméabilité des sols, etc. Cela oblige à considérer les effets en cascade, à utiliser les données pour comprendre les interactions entre les éléments de la ville. La simulation devient un outil au service des experts.

Quelle est la place de la simulation et de la donnée dans la prise de décision ?
Les services des collectivités, et notamment à Lyon, utilisent ces outils pour faire des propositions. Les élus prennent ensuite des décisions, de manière plus éclairée, à partir de ces résultats. Les décideurs peuvent, de fait, prendre conscience, plus facilement, de certaines réalités complexes. La simulation et la donnée peuvent ainsi faciliter la prise de décision dans les stratégies de gestion et de planification urbaine. Le numérique permet de nourrir la décision politique par des scénarios éclairés. Et en la matière, Lyon devient un territoire d’expérimentation très intéressant à l’échelle nationale.
Vous êtes le coordinateur du programme national “Ville durable”. Quels sont les grands enjeux ?
Il s’agit d’un programme national d’accélération financé dans le cadre de l’initiative France 2030, piloté conjointement par le CNRS et l’université Gustave-Eiffel, avec un budget de 40 millions d’euros sur huit ans. L’approche vise à transformer nos espaces urbains et nos constructions en répondant aux défis environnementaux, sociaux et économiques actuels. C’est un défi majeur pour penser la ville de demain. Les grands enjeux associés à cette démarche sont multiples et interconnectés. D’abord, la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité en milieu urbain sont des priorités absolues. Cela implique de repenser l’aménagement urbain pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de créer des espaces favorables à la faune et à la flore. Ensuite, il y a la question de la résilience urbaine. Les villes doivent être capables de faire face aux risques et aux crises, qu’ils soient d’origine naturelle ou anthropique. Cela nécessite de développer des stratégies de prévention et de gestion des risques adaptées. Le troisième pilier est celui de la sobriété et de la frugalité. Face à la raréfaction des ressources, il est crucial de concevoir des villes et des bâtiments qui consomment moins et génèrent moins de déchets. Cela implique de repenser les modes de vie, de production et de consommation en milieu urbain. Un autre enjeu majeur est celui de l’inclusion et de l’équité. La ville durable doit être conçue, aménagée et gérée en impliquant l’ensemble de ses habitants et parties prenantes. Enfin, il ne faut pas oublier la question de la santé et du bien-être. Les morphologies architecturales et urbaines, l’alimentation, les modes de vie et la qualité environnementale sont des déterminants majeurs de la santé et du bien-être en ville.