Lyon est à la pointe sur le prototypage et les expérimentations grandeur réelle de nouveaux outils de planification urbaine par la data et l’intelligence artificielle.
Et si l’avenir de nos forêts urbaines dépendait… d’un algorithme ? À Lyon, planter des arbres n’est plus seulement une affaire de pelles et de bonnes intentions, c’est aussi une histoire de data et d’IA qui repèrent les moindres recoins les plus susceptibles d’être arborés.
C’est tout le sens du projet IA.rbre, un outil d’intelligence artificielle récemment développé par un consortium comprenant TelesCoop (expert en projets data et IA) comme chef de file, la Métropole de Lyon et le Laboratoire d’informatique en image et systèmes d’information (Liris), basé à l’École centrale de Lyon.
Dans un milieu aussi contraint qu’une ville (sous-sols et surface), planter un arbre est tout sauf anodin et peut avoir des conséquences sur les besoins d’entretien, le refroidissement urbain, l’imperméabilité des sols, etc. “Cela oblige à considérer les effets en cascade, à utiliser les données pour comprendre les interactions entre les éléments de la ville”, explique Gilles Gesquière, enseignant-chercheur au Liris. IA.rbre croise des dizaines de jeux de données géographiques pour identifier les lieux propices à la végétalisation. En sous-terrain : réseaux de chauffage urbain, électriques, de gaz, de métro, fibre, conduite d’assainissement et d’eau potable, parkings mais aussi la nature des sols ou la profondeur de la roche. En surface : les bâtiments, la proximité des façades, le mobilier urbain, les voiries selon les usages, les places de stationnement, les accès pompiers, les zones inondables, etc.
Cartes de température
“Les données permettent des analyses plus fines, des croisements impossibles à gérer par le seul cerveau humain”, témoigne Lionel Soulhac, responsable scientifique du LabEx IMU (Intelligence des mondes urbains), un laboratoire d’excellence lyonnais qui favorise l’émergence de projets scientifiques à visibilité internationale. Ce professeur à l’Insa de Lyon a mis sur pied, en 2000, le logiciel Sirane qui modélise la dispersion des polluants en milieu urbain, adapté à l’échelle d’un quartier ou d’une agglomération, aujourd’hui utilisé par toutes les associations françaises de surveillance de qualité de l’air. Inspirés par le modèle Sirane, l’Insa et Centrale Lyon travaillent depuis quelque temps sur des cartes de température. “Le nouvel enjeu est de faire quelque chose de similaire du point de vue microclimatique, explique Pietro Salizzoni, professeur à l’École centrale de Lyon. Au lieu de calculer les concentrations de polluants rue par rue, on veut estimer les températures avec un niveau de détail équivalent.” L’enjeu : produire une cartographie des zones les plus exposées à l’îlot de chaleur urbain, phénomène qui augmente les températures dans l’agglomération, notamment la nuit. “La ville de Lyon est particulièrement exposée car elle ne bénéficie ni des effets modérateurs de la Méditerranée ni de ceux de l’Océan atlantique. Elle est ainsi l’une des plus concernées en France, en termes de fréquence et d’intensité des vagues de chaleur.” Les travaux, en cours, devraient aboutir à un horizon d’un ou deux ans. Lucie Merlier, maître de conférences au Centre d’énergétique et de thermique de Lyon, coordonne même un projet national dédié à la conception et la mise en œuvre de stratégies d’adaptation à la surchauffe urbaine financé par France 2030.

Bus à la demande
Ce n’est pas le seul projet sur lequel Lyon est à la pointe. Centrale Lyon est l’une des deux institutions académiques et de recherche à travailler sur le projet européen ArtMED qui développe une technologie de mobilité autonome à la demande. “C’est un enjeu majeur pour les villes, explique Sylvie Mira Bonnardel, directrice de Centrale Lyon - Enise Saint-Étienne. Aujourd’hui, les modes lourds sont adaptés aux heures de pointe, le matin et le soir, lors de la transhumance des gens au travail. Mais aux heures creuses, la nécessité est moindre. L’idée est de passer à une approche de transports à la demande qui corresponde aux besoins des utilisateurs ; un transport plus souple, qui puisse libérer de l’espace et consommer moins d’énergie.” Le sujet est éminemment complexe. Il faut mettre en place une algorithmie qui permette d’optimiser les déplacements (dimension et déplacements de la flotte de transports publics), en croisant des données dites “de contexte” (nombre d’habitants, d’usagers de bus, de kilomètres de route, les déviations possibles) et “de service” (qu’est-ce que le transporteur promet au client ? Avec quelle fréquence, quel temps d’attente, quel délai entre un point A et un point B ?).
Jumeau numérique
Autre grand projet, l’Hyperviseur, qui prévoit de centraliser, en temps réel, l’ensemble des réseaux (gaz, électricité, fibre, caméras, éclairage public) afin de pouvoir les piloter plus efficacement (détection de fuite ou de panne, régulation du chauffage, extinction d’éclairage public, gestion de parcs photovoltaïques…). Déployé dans l’Ain, et susceptible d’être reproductible à l’échelle nationale, “ce jumeau numérique [réplique numérique, NdlR] relève de l’observation et de la gestion. Il ne simule et n’anticipe pas encore mais sera terminé d’ici environ un an”, précise Sophie Houzet, directrice de la Fabric’O, sorte de “do tank” du Cerema, basé à Lyon, qui fournit expertises, études et recherches pour les collectivités. À Lyon, Erasme, le laboratoire – assez unique en France – d’innovation de la Métropole a accompagné le projet “Parcours à la carte”, une plateforme grand public, encore en phase test, qui permet de proposer des trajets piétons calmes, moins exposés à la chaleur ou aux pollens, voire jonchée de points touristiques. L’objectif est d’éprouver la pertinence de l’utilisation de données en vue d’aider les habitants à se déplacer différemment. “La Métropole de Lyon est assez pionnière avec plus de huit cents jeux de données ouvertes sur la plateforme DataGrandLyon. Ces données nous permettent de prendre des décisions complexes en croisant plusieurs dimensions”, explique Patrick Vincent, directeur de projet à Erasme. “Nous apportons un certain nombre de compétences pour prototyper et expérimenter en grandeur réelle de nouveaux outils et services”, poursuit David Parent, le responsable du labo.
Choix politique
“On ne croit pas au technosolutionnisme, explique Frédéric Lecoin, directeur du Tuba, autre laboratoire d’innovation lyonnais d’une quarantaine de membres publics et privés qui accompagne des projets sur la fabrication de la ville. La donnée est un outil, certes incontournable, mais reste un outil de compréhension, d’aide à la décision.”
Va-t-on vers une société pilotée par la donnée ? “C’est un choix politique, expose Hervé Rivano, chercheur lyonnais, co-auteur de “Données. Quand le numérique produit et gouverne la ville” (Le Capital dans la cité, éditions Amsterdam, 2020). C’est un enjeu éthique majeur. Avec un risque de déresponsabilisation politique en disant : ‘Ce n’est pas mon choix, c’est l’algorithme qui a décidé.’”


















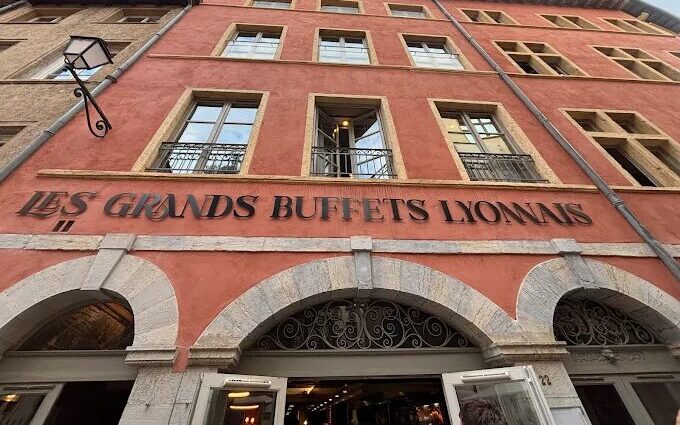





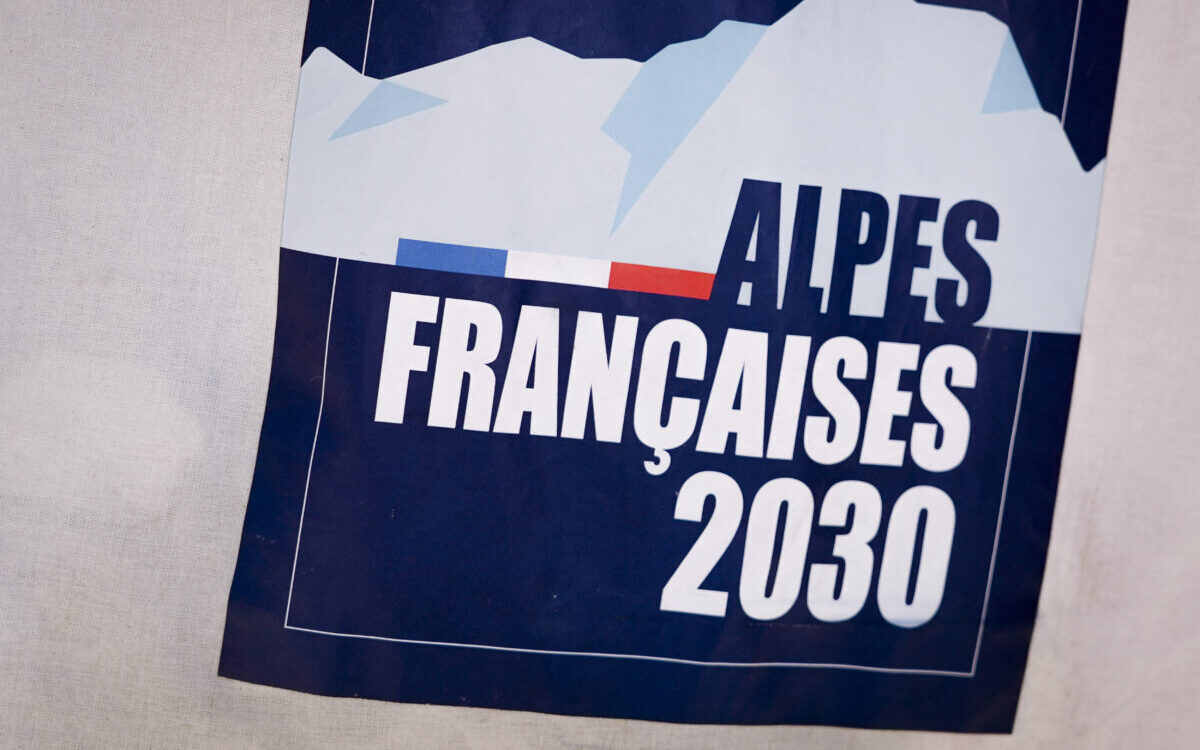
D
Dans la période contemporaine, que retiendront les futurs lyonnais : les constructions fin du XX° ou celles du début XXI° ?