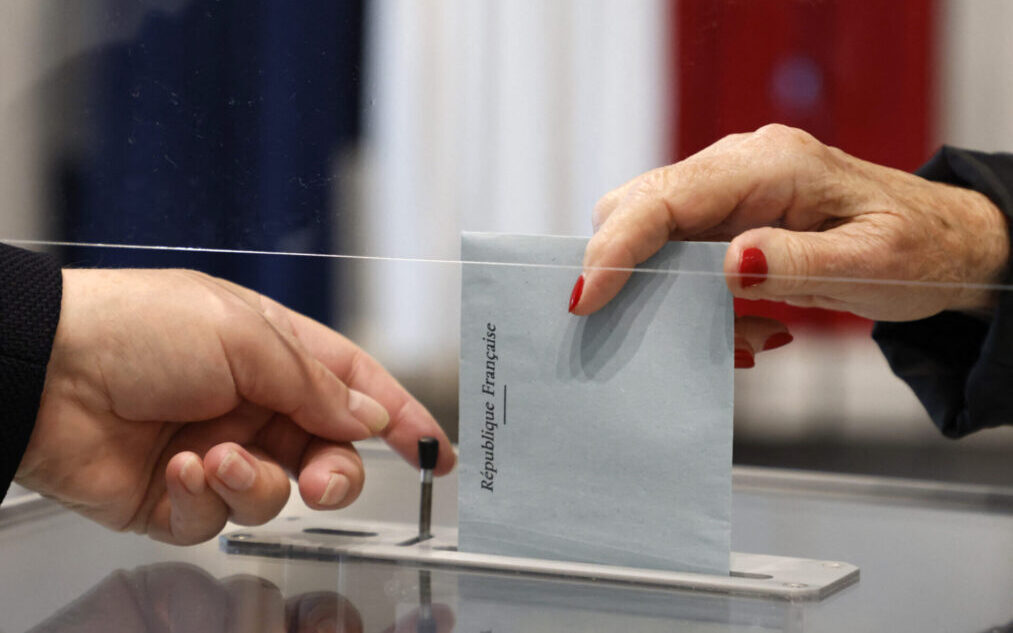Crooner discret et solitaire, façonné par une première vie d’homme lige dans une variété de groupes de rock, Richard Hawley trace depuis près de 25 ans une trajectoire musicale personnelle et impeccable au croisement du lyrisme vocal de Roy Orbison, des maniaqueries misanthropes de Morrissey et des angoisses crépusculaires d’un Scott Walker. Un musicien d’une autre époque et pourtant si contemporain, intemporel et sans âge, de passage à Lyon, en cette rentrée.
Au rayon des crooners, pour ce qu’il reste de cette espèce en voie (et en voix) d’extinction, Richard Hawley n’est pas le plus jeune (mais il n’est pas non plus le plus vieux), il n’est pas bien beau avec son bec de lièvre et ses lunettes de comptable qui lui donnent de faux airs de Buddy Holly et de Roy Orbison (pas vraiment deux apollons eux non plus) et sa banane est toujours un peu tombante. Oui, mais quel charme, et quelle classe. Sans doute, dans la catégorie “homme le plus classe du monde”, immortalisée par Michel Hazanavicius dans sa très culte pochade La Classe américaine, Richard Hawley est-il tout en haut de l’échelle. La classe de Richard Hawley n’est pas américaine, elle est anglaise, infiniment british, mais elle se nourrit évidemment à la fontaine US, depuis la source du blues originel jusqu’aux rivières et fleuves qu’elle a généreusement enfantés en aval, en passant par les ruisseaux qui les alimentent.
Comme souvent, l’affaire est un atavisme. Si Richard a grandi à Sheffield, le fief prolo de Ken Loach, avec pour seul et unique voisinage une aciérie et un cimetière – le labeur ou la mort, en quelque sorte –, son père lui a offert une perspective un peu différente. Dave est un guitariste amateur de très bon niveau. Quand il ne transpire pas au contact du métal en fusion, il se donne dans les pubs locaux avec son groupe. Un temps, il passe même professionnel et, se dédoublant, accompagne des figures d’outre-Atlantique tels John Lee Hooker ou Little Walter. Pour compléter le tableau, la mère de Richard, Lyn, est chanteuse et le frère de celle-ci, Frank White, un guitariste de talent. C’est dans ce genre de contexte qu’un beau jour, âgé de six ans, on attrape la guitare paternelle sous le canapé pour en faire sa raison de vivre, comme Richard Hawley. À quatorze ans, il connaît sa première expérience dans une formation qui reprend des standards du rock’n’roll. Expérience qui le conduit jusqu’en Allemagne.
Homme de l’ombre
Puisque tout doit aller très vite, Hawley enregistre ses premiers EP avec son groupe de lycée, Treebound Story qui se sépare en 1992. Il auditionne ensuite pour Morrissey, sans succès. Puis, il rejoint les Longpigs, groupe notoirement inconnu de ce côté-ci de la Manche mais très apprécié en Angleterre et dont le single On & on connut son petit succès grâce au film Face d’Antonia Bird. Le groupe publie deux albums en 1996 et 1999 puis se sépare. Hawley rejoint ensuite Pulp, formation d’une tout autre envergure, comme guitariste de tournée et sur l’album We Love Life, produit par la légende Scott Walker, statue du Commandeur du crooning déviant et l’un de ses totems.
C’est peut-être cette expérience qui pousse Richard Hawley à remiser son costume d’homme de l’ombre et de guitariste jouant les utilités. Ou la conscience soudain surgie qu’il a bien trop de talent pour se contenter de le mettre au service de celui des autres – ce qui revient en l’espèce à le gâcher. Au tournant du siècle, Hawley s’entoure de quelques amis et enregistre un premier album sans titre, immédiatement suivi de Late Night Final, qui doit son titre à l’expression consacrée des vendeurs à la criée. De criée, il n’est pourtant pas question ici : on découvre la voix d’un guitariste jusqu’ici muet, elle s’épanouit dans la nuance et le velouté, timbre de baryton cajolé par les mélodies et les arpèges cristallins, comme sur le titre Baby You’re my Light, très morrisseyien, et un usage quelque peu désuet de la reverb, comme sur Love of My Life.
Sur Lowedges (2003), cette voix s’affirme davantage, lorgnant plus franchement vers le coucou de Vernon, Roy Orbison, à l’image de Run for Me qui, pourtant, là encore, rappelle Morrissey sans les coquetteries de Castafiore indie. Peut-être parce qu’au fur et à mesure de sa discographie, Richard Hawley trouve une ligne de crête qui jouxte précisément les univers d’Orbison, Morrissey mais aussi de l’Ange noir Scott Walker dont l’œuvre n’a cessé depuis la fin des Walker Brothers de s’enfoncer dans les ténèbres, réinventant l’art du crooning dans une sorte de geste morte-vivante. C’est aux abords de cette approche crépusculaire, qu’il n’hésite pas à inonder des derniers rayons d’un soleil comme éternellement couchant, que se tient Richard Hawley avec une facilité déconcertante et une classe folle. Sans doute faut-il voir là aussi, comme une infusion de l’atmosphère lugubre dont seules les villes comme Sheffield ont le secret (les titres de ses albums font quasi systématiquement référence à des lieux bien connus des habitants de la ville).
Chevalier errant
Cela conduit légitimement à l’un de ses chefs-d’œuvre, Coles Corner (2005), un disque aux arrangements sublimes qui semble avoir été écrit pour une croisière qui ne s’amuserait jamais et finirait mortellement empalée dans un glaçon. L’album est sélectionné pour le Mercury Prize et lorsque les vainqueurs, les Arctic Monkeys, viennent chercher leur prix sur scène, c’est embarrassés, s’excusant d’avoir volé le vrai vainqueur à leurs yeux, Richard Hawley. Lui n’en a cure, il avance en solitaire, sans but précis, tel le chevalier errant – pour Hawley, la solitude est à la fois une malédiction et la seule liberté qui vaille –, regardant la route plus que la destination, mais l’œil volontiers collé au rétro qui lui sied si bien, là où défilent les paysages de la vieille country, du rock’n’roll originel, de la pop de fête foraine ou de casino flottant pour public cacochyme. Comment entendre autrement ce Tonight the Streets Are Ours qui ne jurerait pas deux secondes au générique d’une sitcom américaine des années 70 ? Le titre est le joyau de Lady’s Bridge (encore une référence à Sheffield) qui connaît un joli succès anglais et où Valentine semble, là encore, ravi au “Big O” Orbison. Une fois encore, comme sur Coles Corner, les cordes y sont plantureuses et éplorées, comme agitées d’une sorte de lyrisme blessé.
Beaucoup moins lyrique mais davantage blessé, s’avance Truelove’s Gutter (2009), album terriblement walkerien dans sa noirceur, un certain minimalisme, une dose d’expérimentations et la longueur de certains de ses titres (Remorse Code, Don’t You Cry). Sur la pochette en noir et blanc, très walkerienne elle aussi, le visage de Hawley émerge de la pénombre, laissant jaillir comme une lueur d’espoir. À cette période, le chanteur lutte contre un certain nombre d’addictions et la dépression qui va avec. S’extirpant de cette noirceur, l’album suivant Standing at the Sky’s Edge s’inscrit dans une veine très électriquement rock et à vrai dire d’un psychédélisme qu’on ne connaissait pas à Richard Hawley. On peut y voir une respiration ou une embardée pas très heureuse mais provisoire, le chanteur revenant à ses amours avec Hollow Meadows (2015), disque de convalescence (d’une jambe cassée doublée d’une hernie discale) enregistré sans artifice.
Further (2019) est du même ordre, pas dénué de quelques boursouflures à la Morrissey, il contient quelques moments de grâce et d’émotions. D’une certaine manière, la dernière œuvre de Richard Hawley, In This City They Call You Love, sortie cette année et pour laquelle il se retrouve en tournée, est un concentré de la formule Hawley à l’œuvre depuis un quart de siècle, du rock aux guitares rugissantes, des cordes en cascades et des ballades frissonnantes aux manières rétro sublimant un organe de baryton sur lequel le temps ne semble avoir qu’une prise positive. Si Richard Hawley n’est ni le plus jeune ni le plus vieux des crooners, c’est sans doute parce qu’en réalité les crooners, comme les dieux, n’ont pas d’âge. Ils sont comme les lieux dont Richard Hawley a utilisé la force symbolique plus que la réalité matérielle pour baptiser ses albums : ils se tiennent, immuables dans la valse du temps, sans prendre une ride, changés en souvenir pour l’éternité.
Richard Hawley – Le 12 septembre à l’Épicerie Moderne






 Victor Bosch, le 'papy' rock de Lyon
Victor Bosch, le 'papy' rock de Lyon