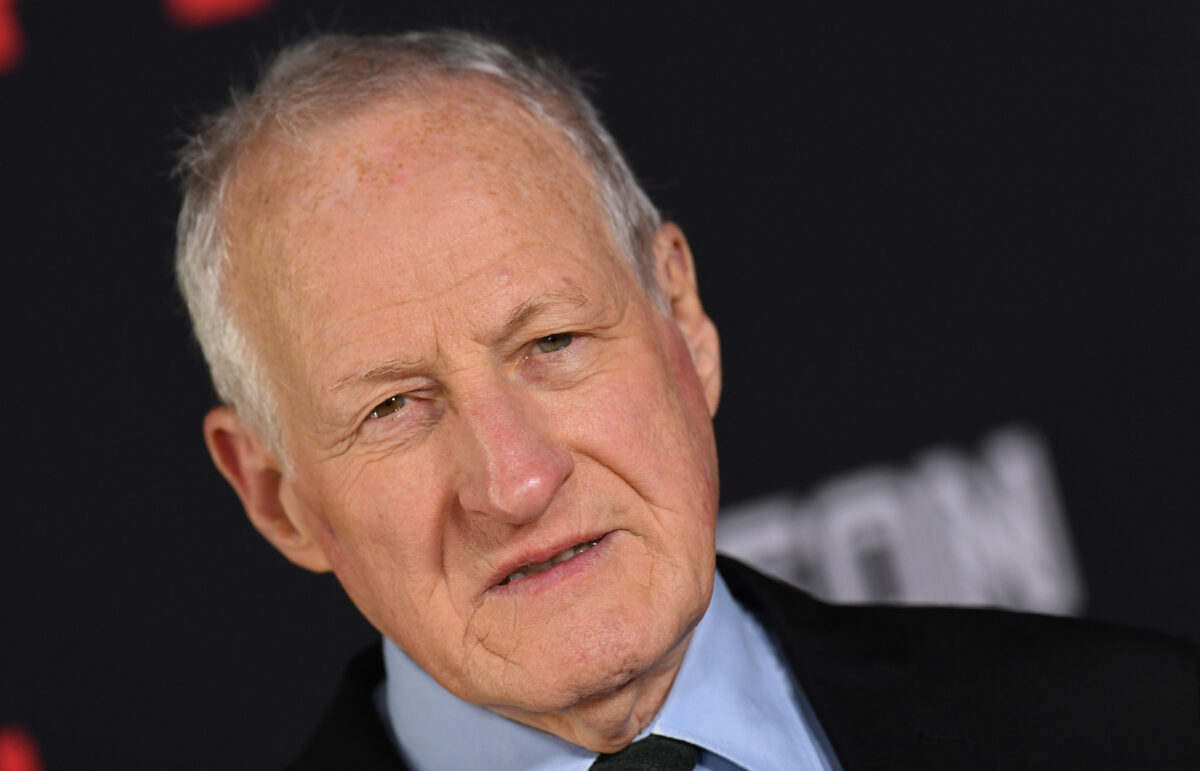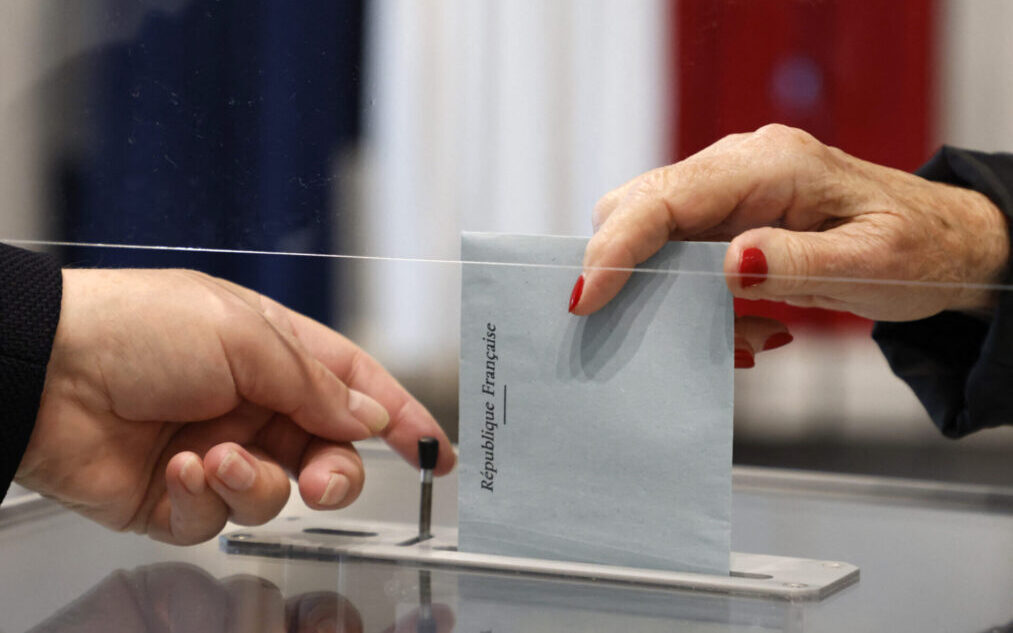La dessinatrice lyonnaise Aurélie Neyret vient de réaliser un reportage en BD sur une maternité tenue par MSF. L’auteure des “Carnets de Cerise” raconte ici pourquoi et comment elle est partie et a séjourné à Khost, en Afghanistan. Quittant pour un temps ses pentes de la Croix-Rousse où elle pratique le kung-fu et défend avec conviction ses idées féministes, véganes et écologistes.
“J’ai envie de vivre dans un monde où toutes les femmes pourraient disposer à leur guise de leur corps”
Lyon Capitale : Vous avez la réputation d’être une grande gueule ?

Aurélie Neyret : (Rires.) Quand il s’agit de parler de moi, je suis plutôt low profile, je n’aime pas trop m’étaler. Mais, si ma voix peut porter, j’essaye de m’en servir pour des causes qui me tiennent à cœur.
D’où votre refus, lorsque la ministre de la Culture Fleur Pellerin vous avait promue en 2016 dans l’ordre des Arts et des Lettres, après la polémique sur l’absence de femmes dans la liste des nominés à Angoulême ?
C’était dans un contexte particulier, où les états généraux de la BD venaient de démontrer la situation alarmante des auteurs et surtout des autrices de BD… Cette nomination, ça donnait l’impression qu’ils avaient tapé “autrices BD” sur Google et s’étaient dit : “On va distribuer quelques médailles pour dire qu’on va dans leur sens.” Parmi les quatre autrices sélectionnées, il y avait Tanxxx. Elle est complètement anar, fait de l’autoédition hyper punk, elle n’en a clairement rien à faire d’une reconnaissance du ministère. S’ils la proposaient, c’est qu’ils n’avaient même pas lu nos BD, c’était presque une injure, en fait. Mais je l’ai surtout refusée pour le côté superficiel de cette réponse, alors qu’il y a de vraies mesures à prendre pour aider les auteurs.
La situation s’est-elle améliorée ?
Il y a sans doute un début de prise de conscience ; cette année, par exemple, le grand prix d’Angoulême a été remis à la mangakate Rumiko Takahashi. Mais, si je réponds oui, on va entendre : “C’est bon maintenant, elles vont arrêter de se plaindre.” Alors que les autrices continuent d’être moins rémunérées que les hommes, pour le même travail, avec des avances moins importantes…
Peut-être parce qu’elles ont moins de succès ?
C’est plus pernicieux que ça. Elles n’ont pas forcément les mêmes chances dès le début, car c’est plus difficile de négocier quand tu es une femme, tu es moins prise au sérieux, de manière générale. Elles sont aussi moins mises en avant, surtout lorsqu’on remonte un peu dans le temps, donc ça entretient l’impression qu’il n’y a pas ou peu de femmes dans la BD.
Nous publions ce mois-ci un BD-reportage que vous avez réalisé dans une maternité afghane de Médecins sans Frontières. Qu’avez-vous découvert sur place que vous n’auriez pas imaginé ?
MSF m’avait remis un rapport anthropologique, donc j’ai pu me préparer et prendre certains chocs chez moi tranquille dans mon canapé. La culture pachtoune (l’ethnie que je visitais) est une société hyper patriarcale, par exemple il n’est pas rare qu’on reproche à une femme qui vient d’accoucher – sans péridurale – d’avoir eu une fille… C’était bien que je puisse rouler des yeux chez moi, ça m’a permis une fois sur place de ne pas être dans le jugement, avec la vision moralisatrice du colon qui vient pour tout changer, car j’avais déjà un peu fait connaissance avec l’ensemble des mœurs. Mon expérience là-bas s’est bien passée, ça a été humainement très enrichissant et fort, même si c’était parfois dur à vivre. Finalement, ce à quoi j’étais le moins bien préparée, c’est le retour en France et le choc des cultures ici. Je suis rentrée juste avant Noël, dans la profusion des publicités et des affiches avec des femmes à poil pour vendre tout et n’importe quoi… C’est une autre manière d’instrumentaliser la femme, on n’est pas parfait non plus. Quand je parlais à des proches des histoires de là-bas, c’était dur d’entendre des jugements sur ces gens que j’ai rencontrés et avec qui j’ai tissé des liens. Ils sont pris dans des traditions, ils n’ont pas le choix, y compris les hommes. Si j’étais née dans une famille de douze enfants en Afghanistan, est-ce que je penserais comme je pense ? Forcément pas.
Du coup, vous militez contre la nudité des femmes sur les publicités ?
Pas du tout. J’ai envie de vivre dans un monde où toutes les femmes pourraient disposer à leur guise de leur corps, sans être jugées pour ça. Cela inclut de poser nues si elles le veulent. Je ne dis pas non plus “on n’est pas mieux ici, alors ne faisons rien”. Mais on ne peut pas libérer les gens, c’est à eux de le faire. On peut à la rigueur offrir des points de comparaison, du recul. MSF n’est pas allé en Afghanistan dans une démarche féministe, ils apportent avant tout l’accès à la santé. Mais, en embauchant 400 femmes dans cette maternité, ça change un peu la société. C’est le premier employeur féminin de la région. Au début, beaucoup d’entre elles commencent par passer la serpillière, parce qu’elles ne savent pas lire et n’ont aucune éducation. Et puis, au contact des autres, elles apprennent, s’inspirent, se forment et deviennent sages-femmes ou infirmières. C’était émouvant de voir ce cercle vertueux et le sentiment très fort de sororité.
“La BD a une plus-value dans la narration : elle permet d’amener de l’émotionnel autrement”
Pourquoi fallait-il le raconter en BD ?

S’il n’y avait pas la BD, on ne pouvait pas en parler en images. C’est une manière de contourner un interdit, puisqu’on ne peut pas prendre de photos des femmes. Et la BD a une plus-value dans la narration : elle permet d’amener de l’émotionnel autrement. Le dessin est moins intrusif qu’un appareil photo. On est obligé de prendre du temps, donc les gens peuvent nous observer travailler, discuter, s’habituer à notre présence. C’est d’autant plus important là-bas qu’ils ne sont pas du tout dans une culture de l’image. Le média, c’est la radio, très peu ont la télé, les gens ne lisent pas comme nous, encore moins de la BD… Pour beaucoup, c’était la première fois que quelqu’un leur tirait le portrait. J’ai accompagné Ludivine Stock [graphiste et auteure-illustratrice lyonnaise elle aussi, NdlR] pour un autre projet à Lyon, dans un foyer pour femmes ; là aussi ça crée des trucs assez touchants. Nous avons rencontré des femmes avec des parcours différents, mais toutes en galère. Pour notre venue, elles s’étaient faites belles, maquillées… Elles ne sont pas toujours habituées à ce regard bienveillant sur leur personne, c’est chouette de pouvoir apporter ça.
“J’avais envie de faire des choses plus concrètes que donner des sous à des associations ou râler sur les réseaux sociaux”
Vous avez réalisé ce reportage dans le cadre d’un partenariat avec une association d’auteurs, The Ink Link. Était-ce un besoin, ce type d’engagement, après avoir terminé la série des Carnets de Cerise ?
Ça s’est fait naturellement. C’est un peu des planètes qui s’alignent. J’avais envie de faire des choses plus concrètes que donner des sous à des associations ou râler sur les réseaux sociaux. Et là, Wilfrid Lupano m’a appelée pour créer une association d’auteurs au service de causes humanitaires… L’association a rapidement développé plein de projets. Ce que j’aime, c’est le côté poly-forme. J’ai fait ce reportage en Afghanistan, mais il y a eu aussi un projet sur une algue polluante en Méditerranée, un sur l’agriculture au Laos, un sur l’insertion des jeunes orphelins en France…
Cette BD sur l’Afghanistan est aussi la première dont vous signez le scénario…
Oui. Ça fait longtemps que je me dis que j’ai des choses à écrire, mais que j’ai peur de ne pas avoir assez de bagage. L’idée, c’était d’ailleurs que Wilfrid fasse le scénario. Depuis l’Afghanistan, je l’appelais tous les jours et rapidement il m’a dit : “Tiens un journal, on ne va jamais se souvenir de tout ce que tu racontes.” Chaque soir, je passais donc une à deux heures à écrire ma journée. Je me suis prise au jeu, je ne racontais pas seulement les événements, mais aussi le contexte, la manière dont je vivais les choses. Au fur et à mesure, c’est devenu de plus en plus intime. Au bout de dix jours, quand Wilfrid a tout lu, il m’a dit : “Vas-y ! Fais-le, le scénario. Ton expérience, tu l’as déjà mise en mots, il n’y a plus qu’à la mettre en forme.”
Sur quoi travaillez-vous aujourd’hui ?

Sur une nouvelle BD jeunesse, avec les scénaristes de La Balade de Yaya, Jean-Marie Omont et Charlotte Girard. Ils m’ont envoyé le scénario il y a quatre ans ; j’ai beaucoup aimé l’histoire, mais j’étais en train de faire le tome 3 de Cerise, je ne pouvais pas les faire attendre. Ils sont revenus en me disant qu’ils ne voulaient pas le faire avec quelqu’un d’autre, et m’ont proposé du coup d’en faire un film. J’ai accepté, mais je n’étais pas sûre que ça marcherait. Les Armateurs [producteurs de films et séries d’animation] ont adoré le projet et ont demandé que ce soit aussi une BD, donc voilà… C’est assez différent de Cerise, dont les histoires sont un peu intemporelles, même s’il y a des téléphones portables. Là, ce sera basé sur une trame historique réelle : ça commence en Italie dans les années 1960 et les héros se retrouvent en Afrique du Sud à l’époque de l’apartheid.
Vous vouliez rester dans la BD jeunesse ?
Non, je n’avais pas forcément de plan. Je ne pensais même pas forcément refaire de la BD, sauf coup de cœur. Je viens de l’illustration, je serais peut-être allée dans d’autres disciplines. La BD, c’est hyper long, frustrant… et vraiment long, je le dis deux fois ! (Rires.) Si j’ai le choix, je ne ferai pas de travail de commande en BD, il faut vraiment avoir une histoire à raconter.
Un lien de famille avec le commissaire Neyret ?
Au moment de l’affaire, on me demandait tout le temps si c’était mon père. À la fin je disais oui, pour mettre les gens mal à l’aise ; du coup ils ne savaient plus quoi dire (rires). Mais, non, il n’y a pas de lien. On a été invités la même année à Quais du polar, mais je ne l’ai même jamais rencontré.
Qu’est-ce qui vous attache à Lyon ?
Franchement, je me le suis parfois demandé. Je trouve qu’il y a un bon équilibre. C’est une grosse ville, parfois un peu trop, mais on peut tout faire à pied ou à vélo. La ville est jolie, les fleuves lui donnent un côté détendu… J’aime beaucoup voyager, à un moment j’ai donc pensé partir. Mais tous mes amis expatriés ne voyagent plus : quand ils ont du temps, ils vont voir la famille et les amis, et c’est un marathon. Je préfère garder mon pied-à-terre dans ma ville, et voyager dès que j’en ai l’occasion. Et puis je me suis trouvé une vraie famille avec les arts martiaux. Je fais du kung-fu à la Croix-Rousse, on fait plein de trucs ensemble, ça renforce mon sentiment d’appartenance à mon quartier.
On n’imaginait pas l’auteure des Carnets de Cerise faire du kung-fu…
On n’est pas obligé d’aller tout dans le même sens dans la vie. Ça me fait du bien. La BD, c’est hyper cérébral, il n’y a que ta main et ton cerveau qui sont mobilisés. Le kung-fu, pendant deux heures, ça m’oblige à être complètement dedans, et pas dans mes petits problèmes de storyboard.
Vous avez tendance à vous énerver ?
Le but, ce n’est pas de taper sur les gens (rires). Je ne fuis pas s’il y a quelque chose à dire, mais je n’aime pas les conflits. C’est pour ça que je suis partie de Facebook ; je me suis dit que ça ne faisait pas avancer le schmilblick… En fait, je suis assez tempérée. Plus jeune, j’étais beaucoup plus à fleur de peau, à m’énerver tout de suite, à rentrer dans le lard inutilement. J’ai réalisé qu’être écorchée vive, c’est fatigant et ça ne rend pas heureux. Mais, quand tu es adolescent, la vie peut être dure, c’est tellement difficile de sortir de sa chrysalide, avec des fois un bagage pas évident. À 30 ans, la vie, c’est super cool. Je n’arrête pas de me le dire, j’ai de la chance quand même. Plus tu t’ouvres, plus tu prends du recul… En vieillissant, je me dis que je ne m’en suis pas si mal sortie quand même, je serais assez mal placée pour me plaindre.
Votre mouvement d’attaque préféré au kung-fu ?
J’aime bien les coups de pied… Mais il n’y a pas d’attaque qui n’aille pas avec une défense. Ce n’est pas juste fait pour taper. Il y a aussi plein de mouvements super élégants basés sur les animaux, que tu ne vas pas sortir si on t’attaque dans la rue, mais j’aime bien ce côté artistique, en plus du self-defence. Franchement, j’aurais dû faire ça beaucoup plus tôt. Le fait de savoir que tu n’es pas démunie si on t’agresse, ne pas paniquer, savoir bloquer quelqu’un qui t’attaque, ça t’apporte beaucoup de sérénité, surtout quand tu es une femme. En soirée, je me dis souvent : si lui me cherche des noises, je sais quoi faire. Avant, comme beaucoup de femmes dans l’espace public, je me sentais souvent comme une proie, une cible.
Un héros ?
Mes grands-parents. Ils ont vécu avec beaucoup moins, ils étaient plus débrouillards, c’est vachement inspirant.
“Nos grands-parents étaient zéro déchet avant nous”
Êtes-vous collapsologue ?
Je n’ai pas cette science-là, mais on ne peut pas nier ce qu’ils disent. On consomme trop, ça ne va pas durer des centaines d’années comme ça… Les trucs jetables, le plastique partout, c’est la génération de mes parents. Nos grands-parents étaient zéro déchet avant nous. Avec mon copain, on essaie de dé-consommer. Mon point noir, c’est le voyage. J’ai voulu faire ça toute ma vie, et maintenant je me dis que ce n’est pas cool pour la planète. Quand j’ai un trajet à faire, j’essaie de le rentabiliser en restant plus longtemps. Sinon, on n’est pas trop mal : on n’a longtemps pas eu de voiture, je ne mange pas de viande… C’est difficile d’être parfait en tout, il ne faut pas non plus se priver de vivre. Chacun négocie ses contradictions comme il peut. Je ne suis pas prête encore à m’installer dans le Larzac, mais on réfléchit à l’idée de se retirer. Je ne me vois pas rester indéfiniment en ville.
Des zéros ?
Les choses qui m’énervent ? Ce sont justement les puissants qui prennent des décisions au nom de tous, qui vont à l’encontre du bon sens, pour la planète et pour les gens, comme Trump, Bolsonaro, les décisions européennes sur les migrations… On va peut-être m’accuser d’être bien-pensante, que c’est parce que je vis dans une bulle de bobos écolos des pentes de la Croix-Rousse ; mais je ne comprends pas trop le problème avec la bien-pensance. C’est comme ceux qui se plaignent qu’on ne peut plus faire de blague raciste ou sexiste… Ils revendiquent quoi ? le droit de mal penser ? Personne n’est parfait, on vit dans une société profondément sexiste, raciste, etc. C’est normal qu’on le soit tous un peu. La différence est entre celles et ceux qui disent “oui, mince, il faut que je déconstruise mon raisonnement, que je travaille sur moi” et ceux qui disent : “Ils font chier ces bien-pensants.”
Quand tu veux militer, tu t’exposes toujours à ce risque : si tu es trop frontal, les gens se sentent jugés, ils se ferment. C’est parfois contre-productif. Mais le temps presse, il faut parfois être brutal, on ne peut pas non plus accepter des choses inacceptables. À titre personnel, quand je suis devenue végane, je m’interrogeais beaucoup et j’avais envie que les gens autour de moi fassent aussi cette révolution personnelle. Je lisais beaucoup de discussions autour de ça, et je voyais “les vegans” dans leur ensemble traités d’extrémistes, et même de “talibans”. C’est dur à encaisser ; le choix des mots, quand même… C’est difficile de trouver un équilibre pour en parler sans soûler et espérer faire un peu avancer les choses.