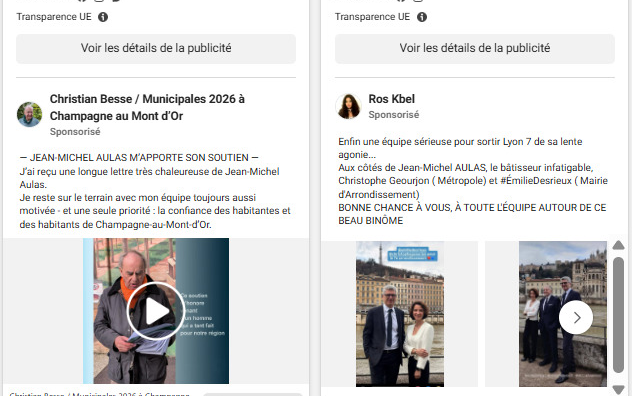De la Vologne à l’affaire de la multinationale Clearstream, Denis Robert n’a cessé de dénoncer les dérives de la presse. Confronté aux pouvoirs politiques et économiques, il a gardé une haute vision du journalisme, une profession qui “ne peut pas se contenter de passer les plats”. Entretien.
Lyon Capitale : Êtes-vous un lanceur d’alerte ?
Denis Robert : Les journalistes ne sont pas des lanceurs d’alerte et les citoyens qui dénoncent des agissements et des structures sont d’abord des témoins. Aujourd’hui, on a changé de nom… Le couple journaliste-informateur/témoin ou lanceur d’alerte est vieux comme le monde. Le journaliste devient médiateur par rapport aux dénonciations et protège le témoin. Selon moi, l’apparition du terme “lanceur d’alerte” manifeste une faiblesse globale du journalisme. La profession se paupérise avec la surinformation sur Internet et la gratuité. Il y a de moins en moins d’argent pour faire des enquêtes libres et indépendantes. Et, en France, l’intérêt des milliardaires et patrons de multinationale détenteurs des journaux n’est jamais l’information, mais toujours l’influence. Dans mes enquêtes, notamment la plus connue, sur la chambre de compensation luxembourgeoise Clearstream, trois témoins m’ont donné des éléments. Si je suis un lanceur d’alerte, c’est plutôt pour avoir dénoncé la manière dont la profession, c’est-à-dire les journalistes, avait travaillé sur ce dossier.
Dans votre dernier livre*, vous évoquez longuement les dérives de la profession sur une autre affaire, celle de la mort du petit Grégory (Villemin), retrouvé dans la Vologne les pieds et les mains liés en 1984. Vous étiez jeune journaliste à l’époque, dans quelle mesure cette affaire vous a-t-elle forgé ?
Dans un fait-divers comme l’affaire Villemin, il fallait absolument résister à tout ce qui était énoncé, en particulier sur la culpabilité de la mère, garder du sang-froid, revenir à la source des informations et maintenir une sorte d’intransigeance. J’ai conservé ce que j’ai appris là-bas. C’était une cure intensive de journalisme. Dans toutes les affaires politico-financières que j’ai sorties, à Libération ou ailleurs, j’ai toujours fonctionné sans haine, en interrogeant systématiquement ceux que je mettais en cause. Être soucieux de la vérité, ce Graal qu’on approche… Avant, j’avais du mal avec le concept de vérité, mais le job essentiel d’un journaliste est d’essayer de l’approcher.
Financement occulte du Parti socialiste avec l’affaire Urba, du Parti républicain avec François Léotard ou pots-de-vin dans le groupe d’hypermarchés Cora : vous avez eu très tôt le goût de l’investigation…
“Journalisme d’investigation” est un pléonasme. Qu’un journaliste écrive sur le sport, la culture ou les affaires, il doit s’interroger, enquêter et ne pas croire ce qu’on lui dit. De mon côté, j’avais la chance d’être dans un journal et de m’intéresser à des sujets où personne n’allait. À l’époque, les fausses factures ou les affaires de corruption n’étaient pas du tout traitées à Libération. Je suis le premier à m’être battu pour qu’il y ait de grands papiers sur ces thèmes. Quelques années plus tard, tous les journaux avaient leur cellule “investigation”. Aujourd’hui, les milliardaires propriétaires de journaux se payent des “journalistes d’investigation” aux dents de lait. Ils mordent moins. Les affaires se banalisent, se noient dans le tas d’infos que balance le Net. Heureusement, Le Canard enchaîné ou Mediapart restent nos meilleurs alliés en matière d’information. Ce que je veux dire, c’est que le journalisme ne peut pas se contenter de passer des plats, de sortir des procès-verbaux ou d’être un auxiliaire de justice. Si j’ai arrêté, c’est parce que j’en avais marre d’être un peu devenu ça… Il y avait d’autres combats à mener, comme l’enquête sur Clearstream. Mais c’est très difficile à faire seul. En cela, c’est bien qu’il y ait une collectivisation, comme on le voit avec le Consortium international des journalistes d’investigation.
Vous auriez souhaité avoir ce type de réseau à l’époque de l’affaire Clearstream ?
Cette histoire est emblématique des difficultés qu’un journaliste peut avoir quand il s’affronte à des pouvoirs. Avant WikiLeaks, LuxLeaks ou les Panama Papers, l’affaire Clearstream participait exactement du même principe : sortir une liste avec des noms et être très attaqué. Je crois que le Consortium de journalistes a aussi existé de nos échecs. Je n’étais pas seul, nous étions un petit groupe de cinq ou six personnes, mais nous avons dû affronter des armées d’avocats et de journalistes parce que nous étions face à une vérité indicible dans nos sociétés. L’aspect positif du Consortium est qu’ils tapent très fort dans plusieurs pays en même temps, donc il y a un impact. Mais, sur les effets dans le réel, en termes de changement dans le rapport à l’argent de ces multinationales ou de ces banques, il ne se passe rien. La justice n’est pas assez indépendante et réactive. Et les politiques se tassent. LuxLeaks en est le plus bel exemple : les types nous font les poches, il y a des preuves, mais pas d’enquête au niveau européen.
Pour Clearstream, votre travail a finalement été reconnu par la justice, dix ans après…

L’affaire Clearstream se solde en effet par une victoire importante. Malgré tous les ennuis, les soixante-trois procédures judiciaires contre moi dans cinq pays, la Cour de cassation a jugé que mon enquête était “sérieuse, de bonne foi et servait l’intérêt général”. Et il existe aujourd’hui pour tous les journalistes une jurisprudence très importante, qui permet de gagner des procès en diffamation quand les journalistes s’opposent à des multinationales ou à des pouvoirs politiques. La jurisprudence Clearstream dit que nous pouvons parfois exagérer, elle offre des libertés nouvelles. On peut avoir une vision négative de la situation en se disant que, pendant les dix années où je me suis battu, je n’ai pratiquement plus fait de journalisme – je n’avais pas le temps ni l’envie d’enquêter sur autre chose. Ceci étant, je pense que c’était très important de gagner judiciairement. Aujourd’hui, on peut dire que Clearstream dissimule, héberge à Luxembourg, son siège, des banques mafieuses, alimentant en argent louche des dizaines de paradis fiscaux. Ce n’est plus diffamatoire. Pourtant, Clearstream continue, increvable… Je les ai peu impactés. Je n’ai aucun regret, ni sur les livres ni sur la manière dont j’ai opéré. Mais j’avais pris la décision de ne plus en parler, car j’étais arrivé à un degré de saturation… D’ailleurs, ça me reprend.
Comprenez-vous les inquiétudes sur la transposition en droit français de la directive européenne sur le secret des affaires ?
Je constate au niveau européen et surtout au niveau français qu’il y a de plus en plus de tentatives pour museler les journalistes et pour attenter à la liberté d’expression. Les pouvoirs d’argent se servent de l’appareil judiciaire et d’un certain nombre de lois pour empêcher des enquêtes. Contrairement à ce qu’on imagine, les journalistes sont assez dispersés, ce n’est pas une profession très syndiquée, il y a beaucoup de pigistes et on a du mal à se défendre. En ce qui me concerne, je n’ai plus de carte de presse depuis presque vingt ans maintenant, mais je suis très attentif à ce qu’il se passe.
Qu’observez-vous ?
Je vois qu’à Metz une décision du tribunal a condamné Édouard Perrin, le journaliste qui enquêtait sur PriceWaterhouseCoopers dans l’affaire des LuxLeaks. Le tribunal a estimé qu’il avait enfreint la loi en divulguant un certain nombre d’éléments qui attentaient à l’économie de cette société, ce qui est quand même énorme. Ces trois mille euros de condamnation, je trouve ça incroyable. Je vois aussi qu’un an avant que le livre Vincent tout-puissant ne sorte, les deux journalistes ont eu des huissiers, car Bolloré les a attaqués pour harcèlement. Quand les types n’arrivent plus à attaquer pour diffamation ou atteinte à la vie privée et qu’ils ont de l’argent, ils vont attaquer pour injures publiques ou harcèlement. Un autre exemple est celui de l’hebdomadaire Challenges, condamné par le tribunal de commerce pour avoir écrit que Conforama s’était placé sous mandat ad hoc. Cela crée des pressions. Je trouve désespérant que les tribunaux se soumettent à cet ordre et qu’il n’y ait pas de contre-offensive plus virulente.
L’affaire Clearstream vous a poussé à réunir sept grands magistrats anticorruption dans l’espoir d’un espace judiciaire européen. Peut-on imaginer un nouvel appel de Genève, vingt ans plus tard ?
L’appel de Genève reste dans les mémoires comme un moment assez unique. Ce qui est affligeant, c’est que l’idée simple d’un partage d’informations entre les magistrats qui instruisent ce type d’enquête n’est toujours pas appliquée. Aujourd’hui, il y a un parquet européen, des tentatives et des améliorations, mais la situation reste la même : les capitaux circulent librement, les intermédiaires sont souvent apatrides avec des passeports de plusieurs pays ; en face, les magistrats sont muselés et à l’étroit dans les frontières nationales. Je ne crois pas au souverainisme et je suis profondément européen en cela. À mes yeux, c’est une évidence : davantage de frontières entraîne un effet mécanique d’augmentation de la corruption et facilite l’achat de passe-droits dans les pays par des corrupteurs apatrides. Là où c’est compliqué, c’est qu’il faut changer l’Europe.
Est-ce possible ?
Les élections européennes sont très importantes pour changer de politique. J’ai peu d’espoir de changement. C’est ectoplasmique. Avec à la tête de la Commission Jean-Claude Juncker, l’ancien Premier ministre luxembourgeois, on a un immense handicap. Il a fabriqué ce système inégalitaire dans lequel on sombre et qui fait monter les droites extrêmes en Europe. C’est rageant de voir ainsi sombrer le navire Europe. Juncker a été mis en place par la grâce de François Hollande et d’Angela Merkel. Londres a fermé les yeux. C’est lamentable. On en voit les conséquences aujourd’hui.
Et le modèle allemand ?
Il y a plus de pauvres en Allemagne qu’en France. Ceux qui ont le pouvoir n’ont pas intérêt à ce que l’Europe change. Mais, autant à gauche qu’à droite, il y a une trop grande disparité parmi ceux qui voudraient lutter contre cela. Personne n’arrive à se mettre d’accord sur un modèle commun. Voir que chaque année les classements de Forbes montrent des milliardaires de plus en plus riches quand l’appauvrissement est partout me donne vraiment le sentiment d’assister à l’histoire du Titanic.
Qu’en est-il de la lutte contre les malversations financières à l’international ?
La situation n’évolue pas dans le bon sens. Malgré la crise de 2008, le shadow banking et la spéculation continuent. Dans les paradis fiscaux, il y a eu quelques mouvements, mais le problème reste géopolitique. La Suisse a fait un certain nombre d’efforts sous la pression des Américains, mais Singapour a pris sa place. Quant aux États-Unis, la pression sur la Suisse ne leur a pas fait remettre en question l’État du Delaware, leur propre paradis fiscal. Ces questions ne sont pas le souci de Donald Trump. Très endetté en tant qu’homme d’affaires, il a triomphé dans son bras de fer avec le fisc américain. Mais il ne faut jamais oublier que Trump est au départ un milliardaire tricheur, qui aurait pu couler le Trésor des États-Unis. On le sauve, car le faire payer, c’était mettre au chômage des milliers d’Américains. En Russie, Vladimir Poutine et sa bande d’oligarques se sont grassement servis dans les paradis fiscaux. Et, à la tête de la France, Emmanuel Macron est un ancien banquier de chez Rothschild, la maison des fusions-acquisitions et de l’optimisation fiscale. C’est déprimant, non ?
Selon vous, qu’est-ce qu’un résistant en 2018 ?
En France, il y a mille sujets d’indignation. À commencer par la manière dont sont traités les migrants…
Mais, un journaliste résistant, c’est quoi ?
C’est sortir l’affaire Kadhafi et ses liens avec l’ancien pouvoir. Des journalistes soi-disant libres et indépendants ont fait des courbettes à Nicolas Sarkozy et n’ont jamais voulu voir des évidences. Nicolas Sarkozy, dans l’affaire libyenne, est un Cahuzac bis. Il faut savoir résister à la connerie ambiante et au journalisme mou. Les médias reprennent des éléments de langage qui ramollissent l’esprit. Il faut lutter contre ce ramollissement général. Le doute est dans l’ADN de cette profession. Il faut écouter sa petite voix, ne pas avoir peur du ridicule. Un journaliste ne devrait jamais vieillir, on doit toujours rester l’enfant qu’on a été.